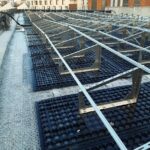0,09 €/kWh : voici le prix incroyablement bas du futur parc éolien flottant de Bretagne
Treize éoliennes géantes et une électricité vendue 86,45 euros le mégawattheure : c’est le très faible tarif de rachat qu’a promis le vainqueur du premier appel d’offre éolien flottant commercial au large des côtes bretonnes. Pennavel, société du consortium composé d’Elicio et BayWa r.e. développera un parc d’une puissance minimale de 250 mégawatts (MW).
Les éoliennes du futur parc de Bretagne sud, premier parc éolien flottant commercial de France, s’élèveront à 29 km de l’île de Groix et 19 km de Belle-île. Le chantier démarrera en 2029 pour une mise en service prévue en 2032. Il y a quelques semaines, l’État a annoncé le nom de l’entreprise lauréate de l’appel d’offres, qui aura donc la charge de concevoir et d’exploiter le parc : il s’agit d’un consortium composé d’Elicio et de BayWa r.e.
Un appel d’offres particulièrement surprenant. Outre l’étonnant désistement du véritable lauréat, le tarif d’achat promis par Elicio et BayWa r.e. est nettement plus bas que ses concurrents : 86,45 euros le mégawattheure (€/MWh). Lors du débat public organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP) en 2020, la maîtrise d’ouvrage avançait plutôt le chiffre cible de 120 €/MWh. Elle justifiait ce tarif compte tenu du « caractère innovant du projet, basé sur des technologies encore en phase de démonstration et qui ne bénéficie que de peu de retours d’expérience dans le monde et en Europe. » La valeur moyenne des offres se situait autour de 101,74 €/MWh, légèrement en deçà des coûts moyens de production estimés par le ministère de la Transition écologique, entre 120 et 150 €/MWh. À titre de comparaison, les trois fermes pilotes flottantes (entre 25 et 30 MW chacune) en Méditerranée ont obtenu un tarif de rachat de 240 €/MWh.
À lire aussi Éolien en mer : la carte des parcs et projets en FranceUne course effrénée à la baisse de prix de l’éolien
Il existe donc une course à la baisse des tarifs de rachat, afin de justifier une certaine maturité de la technologie éolienne flottant. Les tarifs de rachat sont composés du prix auquel le producteur vend son électricité sur le marché et du complément de rémunération (argent versé par l’État pour combler la différence). En l’occurrence, si le consortium avait remporté l’appel d’offre à 120 €/MWh, il explique qu’il aurait touché 80 millions d’euros par an, soit 1,6 milliard sur 20 ans. Avoir des vainqueurs d’appel d’offres au plus bas prix de rachat est une bonne nouvelle pour l’État. Car le soutien financier aux renouvelables diminuera, mais lorsqu’il est trop bas, cela peut compromettre la viabilité du projet.
Si l’appel d’offre a pris des mois de retard, c’est bien parce que le premier lauréat s’est désisté après avoir proposé un prix trop risqué. Le second, actuel lauréat de l’appel d’offre, n’est pas en reste : la CRE a lancé une procédure relative aux offres comportant un tarif sous-évalué. L’objectif de cette procédure est de déterminer si le constructeur exploitant propose un prix en accord avec ses vrais coûts de construction et d’exploitation. À son terme, la Commission de régulation de l’énergie a justifié « ne pas avoir éliminé l’offre » en considérant que les risques pesant sur le projet, à savoir une dégradation du taux de retour sur investissement pour les actionnaires, ne seraient pas de « nature à remettre en cause la décision d’investissement. »
Les éoliennes flottantes, plus chères que les autres
Les parcs éoliens en mer flottants sont plus éloignés des côtes, donc généralement moins visibles, que leurs homologues ancrés au fond de la mer. Les régimes de vent y sont plus favorables alors leur construction est intéressante pour produire plus d’électricité avec des éoliennes plus grandes. Mais faire flotter une éolienne reste un défi, car les facteurs de déstabilisation sont nombreux. Il s’agit de gérer le mouvement de la mer et des pales, la hauteur (chacune mesurera entre 250 et 300 mètres) et le poids de la turbine. Le raccordement est aussi un enjeu central. Il est la source d’une élévation des coûts, à la charge des contribuables puisque Réseau de transport d’électricité (RTE) les supporte (et ne sont pas compris dans le tarif d’achat). Un représentant de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) avançait un coût de raccordement de 15 €/MWh pour ce parc.
L’article 0,09 €/kWh : voici le prix incroyablement bas du futur parc éolien flottant de Bretagne est apparu en premier sur Révolution Énergétique.