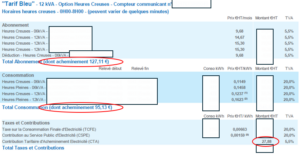En France, nous avons assisté en 2023 à un bond de 20 % de la puissance photovoltaïque installée. Or, plus de photovoltaïque, c’est aussi plus de production locale, et moins de revenus pour le réseau de transport et de distribution de l’électricité. Au point que certains envisagent un véritable effondrement du financement de cette infrastructure. Mais est-ce vraiment le cas ? C’est ce que nous allons vérifier dans cet article.
Depuis 2002, le secteur électrique est divisé entre sociétés de production et de commercialisation d’une part (EDF, par exemple), et sociétés de transport et de distribution de l’autre (RTE et Enedis). À la suite de cette séparation, le réseau est financé par un dispositif spécifique appelé TURPE, acronyme pour « Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité ». Selon les typologies de consommateurs, il existe plusieurs TURPE, c’est pourquoi l’on parle le plus souvent « des » TURPE, au pluriel. Les TURPE ont pour finalité de rémunérer les entreprises ayant la charge du service public de transport et de distribution de l’électricité, à savoir :
- Réseau de transport d’électricité (RTE), gestionnaire du réseau haute tension supérieur à 63 kilovolts (kV).
- Enedis (anciennement ERDF), principal gestionnaire du réseau moyenne et basse tension,
- les Entreprises locales de distribution (ELD) dans certaines communes.
Les prix sont fixés par une autorité indépendante, à savoir la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui les révise régulièrement, aujourd’hui avec une périodicité de quatre ans.
Comment le TURPE est-il payé par le consommateur ?
Les TURPE sont calculés pour couvrir les coûts de construction, de développement et de maintenance du réseau. Ils couvrent également en partie les coûts de raccordement, ainsi que les coûts de recherche et développement. Les TURPE 6 sont les tarifs en vigueur depuis le 1ᵉʳ août 2021, et ils resteront en application jusqu’en 2025. Tous les consommateurs d’électricité payent le TURPE. Pour les petits consommateurs, le TURPE est collecté par le fournisseur d’électricité auprès de ses clients, directement sur leur facture. Son montant est ensuite intégralement reversé par le fournisseur aux gestionnaires des réseaux. Le montant peut figurer sur votre facture, c’est le cas, par exemple, pour EDF.
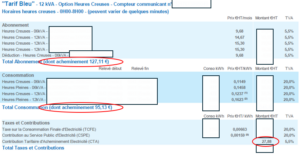
Dans l’exemple de facture ci-dessus, la contribution au réseau figure sous plusieurs formes. Une part fixe figure dans la section « abonnement » de la facture, et une part variable figure dans la section « consommation ». Ces contributions représentent environ un tiers ou la moitié de la facture hors-taxe. La dernière composante de la facture est appelée « Contribution Tarifaire d’Acheminement Électricité » (CTA), c’est une taxe destinée, elle aussi, à financer le réseau de transport et de distribution, ainsi que les retraites des agents du régime des industries électriques et gazières. Elle s’élève autour de 20 % du prix d’acheminement.
Les tarifs sont variables selon la situation du consommateur
Nous allons nous pencher sur plusieurs situations de consommateurs / autoproducteurs individuels (non collectifs), et ce pour des compteurs réglés à une faible puissance (< 36 kVA). Il y a trois cas à envisager :
- Un consommateur simple sans installation de production photovoltaïque
- Un autoproducteur sans contrat de revente
- Un autoproducteur bénéficiant d’un contrat de revente
Enedis édite un descriptif du TURPE HTA-BT, sur lequel nous allons nous baser. Pour les particuliers et les professionnels qui ont un abonnement inférieur à 36 kVA, trois composantes permettent de calculer le montant du TURPE : la composante de gestion, la composante de comptage et la composante de soutirage. Pour la première, la composante de gestion, son prix est différent selon la situation du consommateur :
- Pour un consommateur ou pour un autoproducteur sans contrat de revente, le coût est le même, à savoir 15,48 €/an,
- Pour un autoproducteur bénéficiant d’un contrat de revente, cette composante s’applique en principe dans les deux sens : pour l’injection et pour le soutirage. Toutefois, une règle est mise en œuvre pour conduire à un montant inférieur à la somme des deux contributions, à hauteur de 24,36 €/an.
À lire aussi
Photovoltaïque : doubler son taux d’autoconsommation, c’est possible
Concernant la composante annuelle de comptage, elle est destinée à couvrir les frais liés au compteur, à savoir sa location, son entretien et sa relève. Elle est identique pour les trois situations, à hauteur de 19,92 €/an.
Concernant la dernière composante, la composante de soutirage, son calcul est plus complexe, car il dépend d’options de tarification et de classes de prix qui sont fonction de la saisonnalité. Ce qu’on peut toutefois retenir, c’est que la tarification est :
- D’une part proportionnelle à la puissance souscrite, avec une valeur pouvant varier selon l’option, mais de l’ordre de 10 €/kVA. Ainsi, avec un compteur à 9 kVA, le coût sera de l’ordre de 90 €/an,
- D’autre part, proportionnelle à l’énergie consommée, avec une valeur pouvant assez fortement varier, en fonction de l’option et du moment de consommation. Pour une option sans saisonnalité, il peut être, par exemple, de 4,37 c€/kWh. Si l’on considère une consommation de 2 MWh/an, le coût représente environ 87 €/an.
L’autoconsommation nuisible au réseau ? Le verdict
Comparons les trois cas dans le tableau ci-dessous, moyennant quelques hypothèses :
| Situation |
Consommateur en soutirage seulement |
Autoproducteur sans contrat de vente |
Autoproducteur avec contrat de vente |
| Composante annuelle de gestion |
15,48 €/an |
15,48 €/an |
24,36 €/an |
| Composante annuelle de comptage |
19,92 €/an |
19,92 €/an |
19,92 €/an |
| Puissance du compteur |
6 kVA |
6 kVA |
6 kVA |
| Consommation annuelle totale |
2 MWh |
2 MWh |
2 MWh |
| Soutirage du réseau |
2 MWh |
1 MWh |
1 MWh |
| Autoconsommation |
0 MWh |
1 MWh |
1 MWh |
| Composante annuelle de soutirage |
147 €/an |
103 €/an |
103 €/an |
| Prix total acheminement (hors-taxe) |
183 €/an |
139 €/an |
148 €/an |
| Diminution |
– |
-24% |
-19% |
Nous le voyons, dans ces cas fictifs, la diminution de la part de la facture électrique liée à l’acheminement est modeste, de l’ordre de 20 % (hors-taxes). Nous avons pourtant considéré une autoconsommation de 50 %, soit une diminution d’autant du soutirage d’électricité sur le réseau. Dit autrement, nous constatons que les autoproducteurs payent plus cher chaque kilowattheure d’électricité achetée au réseau. Nous sommes donc loin d’une situation pouvant amener à l’effondrement des revenus et du financement du réseau. La seule situation conduisant à une facture nulle serait celle d’une autonomie totale, avec un bâtiment complètement déconnecté du réseau. Mais dans ce cas, aucune électricité ne serait soutirée, et le réseau ne serait aucunement sollicité. Il serait alors bien entendu malvenu d’exiger un payement pour son usage.
L’article Panneaux solaires : l’autoconsommation va-t-elle tuer le réseau électrique national ? est apparu en premier sur Révolution Énergétique.