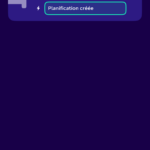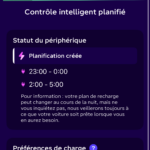Stockage d’électricité : ce pays d’Europe va construire une STEP aussi puissante que celle de Grand Maison en France
Elle devrait afficher la même puissance que notre fleuron national : la station de transfert d’énergie par pompage-turbinage (STEP) de Grand’Maison. La future station de pompage-turbinage du Loch Earba, dont le permis de construire vient d’être approuvé, devrait jouer un grand rôle pour le réseau électrique du Royaume-Uni qui souffre de perturbations fréquentes.
Elle pourra alimenter 1,4 million de foyers écossais pendant 22 heures à pleine puissance. La future plus grande STEP du Royaume-Uni vient de faire un pas de plus vers sa mise en service, avec l’obtention du permis de construire. Cette station de pompage-turbinage, qui sera implantée au Loch Earba, affichera une puissance de 1,8 GW pour une capacité de stockage de 40 GWh. Au total, elle devrait demander 6 à 7 ans de travaux et nécessiter la création de 500 emplois.
Désormais, les entreprises Gilkes Energy et SSE Renewables ont la lourde tâche de trouver les financements nécessaires à la mise en œuvre du projet. Pour faciliter cette démarche, les deux entreprises ont recours au Cap and floor, un mécanisme financier mis en place par le gouvernement britannique, et dédié au stockage d’électricité de longue durée. Ce système garantit aux porteurs de projet un revenu minimal et limite le revenu maximal afin de les protéger des fortes fluctuations du marché de l’électricité.
À lire aussi Stockage d’électricité : ce pays d’Europe va construire une STEP aussi puissante que celle de Grand Maison en FranceLe stockage d’électricité, élément incontournable d’un réseau électrique déséquilibré
Cette STEP pourrait ne pas être la seule, car le Royaume-Uni cherche à fortement développer ses capacités de stockage d’énergie. Avec le développement massif des parcs éoliens offshore au large de l’Écosse, le réseau électrique se retrouve fortement déséquilibré, avec une grande part de la production au nord du pays et la majorité de la consommation au sud. L’Écosse possède, en effet, 17,8 GW de capacité de production installée pour des besoins limités à 4 GW du fait de ses 5,4 millions d’habitants. Du fait de cette situation, le réseau atteint parfois ses limites, notamment à cause de certaines portions sous-dimensionnées du réseau électrique entre l’Écosse et l’Angleterre. Ainsi, les éoliennes doivent être bridées tandis que des centrales à gaz sont allumées dans le sud du pays.
Le développement de moyens de stockage, que ce soit grâce à des batteries ou des STEP, permettrait de limiter ce phénomène en redistribuant la production électrique de manière plus homogène.
L’article Stockage d’électricité : ce pays d’Europe va construire une STEP aussi puissante que celle de Grand Maison en France est apparu en premier sur Révolution Énergétique.