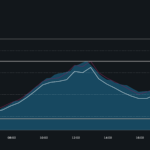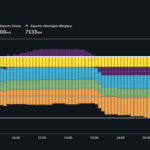Vous souhaitez faire plaisir à un fan des énergies à Noël ? Pas facile de trouver un cadeau pour satisfaire cette passion peu commune. Nous avons sélectionné cinq articles très variés, de la petite prise connectée au livre en passant par le kit solaire en autoconsommation, qui pourraient faire effet au pied du sapin.
Entre le traditionnel coffret Scorpio et les Ferrero Rocher, certains cadeaux pourraient se démarquer à Noël. Surtout s’il s’agit de faire plaisir à un energy geek, terme que nous venons d’inventer et qui pourrait désigner les passionnés d’énergies. Ceux qui se régalent, comme nous, en découvrant les entrailles des centrales électriques, en mesurant la consommation des appareils ou en produisant leur propre électricité. Il faudra faire de la place au pied du sapin si vous optez pour un kit solaire en autoconsommation tel que celui que nous proposons dans cet article. Un compteur connecté ou un ouvrage particulièrement bien documenté sur l’énergie nucléaire est peut-être plus raisonnable. On vous laisse le choix.
1 – Le kit solaire autoconsommation Beem
À moins de 200 €, ce kit solaire propose 4 petits panneaux photovoltaïques de 75 Wc totalisant 300 Wc, particulièrement esthétiques puisqu’ils arborent le motif floral emblématique de la marque française Beem. L’ensemble est prêt à brancher grâce au micro-onduleur à prise domestique inclus et peut être placé au sol ou fixé contre un mur. C’est un petit budget pour un cadeau de Noël, certes, mais pas si cher pour découvrir l’autoconsommation solaire. À offrir à quelqu’un (que vous appréciez !) disposant, bien évidemment, d’un grand balcon ou d’un jardin.
2 – Le thermostat connecté pour climatiseur réversible Netatmo
Cette commande connectée imite la télécommande de presque n’importe quel climatiseur réversible (pompe à chaleur air/air) afin de le rendre contrôlable à distance. Grâce à l’application smartphone Home+Control, on peut réaliser un grand nombre de réglages comme la température de consigne, des horaires de chauffe ou de refroidissement, des plannings. Un thermomètre et hygromètre intégrés permettent également de suivre l’évolution de ces paramètres dans la pièce concernée. Nous l’avons testé (lire notre article) et avons été satisfaits du service rendu.
3 – Le compteur connecté Shelly Pro 3EM
Pour suivre la consommation électrique de son logement ou d’appareils, il existe une grande variété de solutions. L’une des plus complètes et renommées à ce jour est le compteur à tores (transformateurs de courant) à placer sur chaque phase, accessibles dans le tableau électrique général. La marque Shelly propose des compteurs très fiables dotés de nombreuses fonctionnalités. Le modèle Pro3EM peut mesurer jusqu’à 3 phases, ce qui convient pour les logements triphasés, mais pas seulement. Un logement monophasé pourra surveiller sa consommation générale en plus de deux appareils, comme une pompe à chaleur, un ballon d’eau chaude ou une pompe de piscine, par exemple.
4 – La prise connectée Shelly Plug S
C’est le plus économique des cadeaux que nous vous suggérons, mais il reste très qualitatif. Il s’agit d’une simple prise connectée, qui ne requiert donc aucun branchement compliqué, mais peut rendre bien des services. Ce modèle de dernière génération conçu par Shelly permet d’éteindre ou d’allumer un appareil à distance via un smartphone (en Bluetooth ou wifi) selon ou non un planning. Il peut aussi mesurer assez précisément la consommation électrique de l’appareil, ce qui est un vrai avantage. Vous pourrez facilement savoir quel appareil consomme le plus chez vous et prendre des mesures appropriées pour réaliser des économies d’énergie.
5 – L’énergie nucléaire en 100 questions de Maxence Cordiez
Notre dernière idée-cadeau est particulièrement low-tech puisqu’il s’agit… d’un livre composé de papier. Mais pas n’importe lequel. « L’énergie nucléaire en 100 questions » répond à la plupart des interrogations que l’on peut se poser sur la production d’électricité nucléaire, dont nous sommes totalement dépendants en France. Ce mode de production, comme d’autres, souffre de nombreuses idées reçues, auxquelles l’ingénieur Maxence Cordiez tente de répondre avec beaucoup de pédagogie. Ce livre est accessible à tous et on y apprend beaucoup.
ℹ️ Cet article comporte un ou plusieurs liens d’affiliation, qui n’ont aucune influence sur la ligne éditoriale. C’est l’un des modes de financement de notre média qui nous permet de vous proposer gratuitement des articles de qualité.
L’article Noël : 5 idées cadeau pour les geeks de l’énergie est apparu en premier sur Révolution Énergétique.