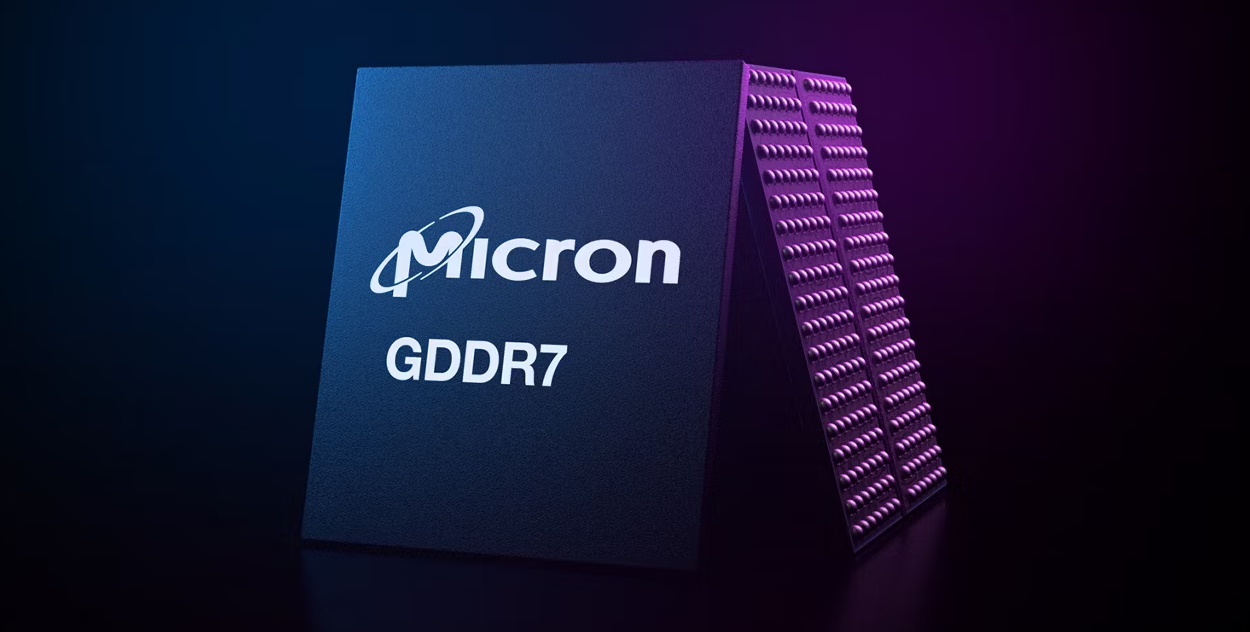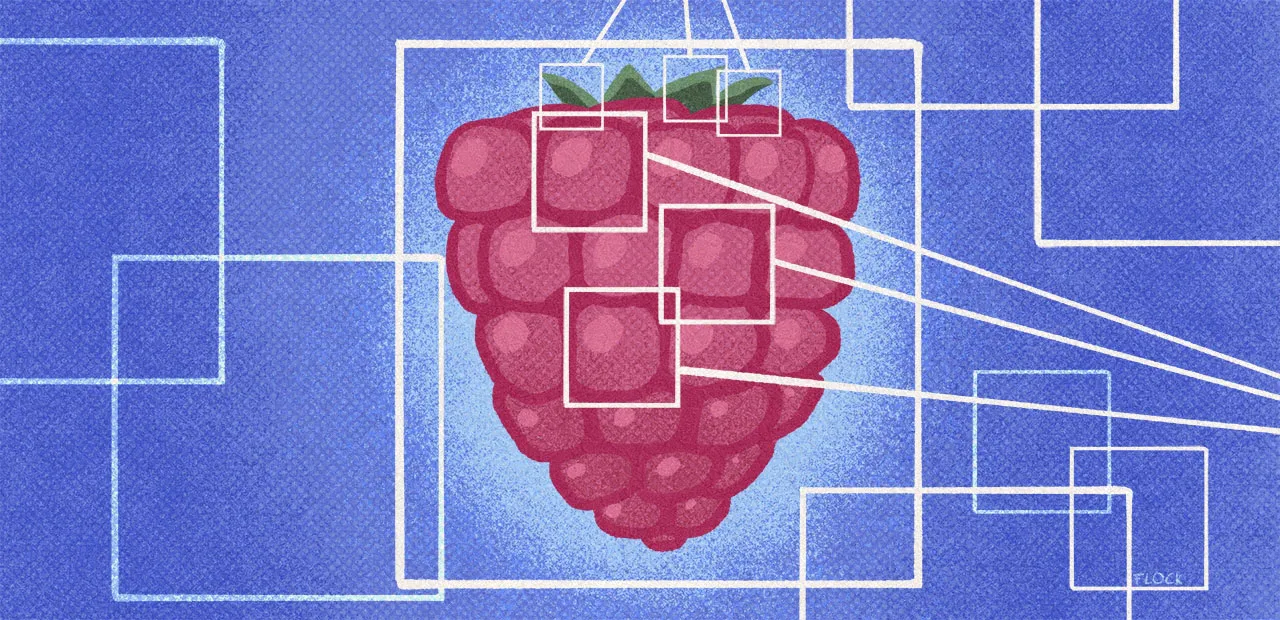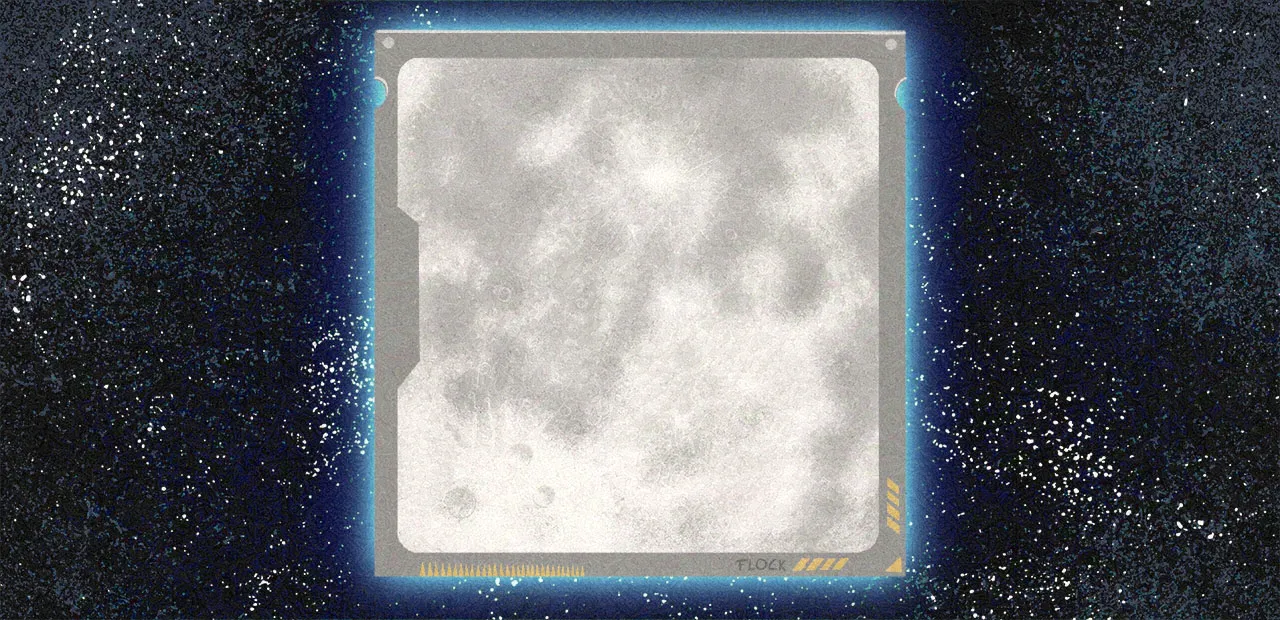Carburants solaires, photoscience, santé : 40 millions d’euros pour exploiter la lumière
Lumos Maxima !

Dans le cadre du plan d’investissement France 2030, le gouvernement, le CEA et le CNRS viennent de donner le coup d’envoi officiel d’un « ambitieux programme de recherche pour explorer la lumière de manière inédite ». Un des axes concerne les carburants solaires.
Il s’agit d’un nouveau PEPR (Programmes et équipements prioritaires de recherche) baptisé LUMA (Lumière-Matière) dont le but est d’« exploiter les propriétés de la lumière pour explorer et contrôler de nombreux systèmes physicochimiques et biologiques ».
Le projet vient d’être officiellement lancé (même s’il existe depuis longtemps) avec un financement de 40,38 millions d’euros sur sept ans, dans le cadre de France 2030. Il est co-piloté par le CEA et le CNRS. 1 000 chercheurs sont mobilisés et 28 universités impliquées.
De vastes débouchés
Les débouchés potentiels sont nombreux, comme l’explique le CNRS : traitement et stockage de l’information, matériaux durables (chimie verte, recyclage, écoconception), exploitation énergétique (solaire) et photomédicaments (méthodes non-invasives, thérapie photodynamique, traitement du cancer).
Attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs : on parle de recherche fondamentale, pas de remède miracle à court terme. Catalin Miron (directeur de recherche CEA et co-dirigeant de ce projet), précise d’ailleurs qu’il s’agit d’un « PEPR exploratoire, qui anime donc de la recherche amont », on n’est pas dans une phase d’industrialisation, mais de recherche pure.
Le centre de recherche en profite pour affirmer que la France est le leader international dans la valorisation des interactions lumière-matière avec pas moins de cinq prix Nobel depuis 2016 : Jean-Pierre Sauvage (2016), Gérard Mourou (2018), Alain Aspect (2022), Pierre Agostini et Anne L’Huillier (2023 tous les deux). Pour le ministère de la Recherche, la France doit « maintenir et consolider son positionnement, à la fois académique et industriel ».
Photoscience intelligente, technologies vertes et protection
Trois axes de développement sont mis en avant avec LUMA :
- Photons for Green, « qui vise à l’émergence de nouvelles technologies « vertes » haute performance pour l’énergie et l’industrie de demain ». Il est notamment question de « la conversion efficiente de l’énergie solaire en énergie chimique, en produisant des carburants solaires ».
- Light for Protection vise de son côté à « utiliser la lumière pour une meilleure préservation de la santé, de l’environnement ou des objets de notre patrimoine ». L’enjeu n’est rien de moins que de diagnostiquer et soigner grâce à la lumière.
- Enfin, Smart Photoscience ambitionne de « décrypter des systèmes et des dynamiques complexes en chimie, physique, biologie, pour les faire fonctionner par des processus de photo-activation sophistiqués ».
Le programme propose aussi des actions ciblées de recherche, sélectionnées via un appel à manifestations d’intérêt. Quatre axes de développement sont mis en avant : la chiralité, la photochimie et les matériaux, l’énergie et l’environnement, la santé. Des appels à projets collaboratifs sont également dans les cartons.
Deux révolutions scientifiques et techniques
L’année dernière, Rémi Métivier justifiait ce projet par deux « révolutions scientifiques et techniques majeures, survenues ces dernières années », offrant de « nouvelles perspectives quant à l’utilisation de la lumière ».
La première vient du contrôle de la lumière : « Nous avons accès à des sources lumineuses très performantes, notamment avec des lasers à impulsions ultra-courtes (femtoseconde ou attoseconde) ». LUMA s’intéressera à la structuration de la matière « aux échelles ultimes de temps et d’espace (attoseconde et nanomètre) ».
On parlait récemment de l’attoseconde : c’est un milliardième de milliardième de seconde (10⁻¹⁸ seconde). À titre d’exemple : « il y a autant d’attosecondes dans une seconde que de secondes depuis le Big Bang ».
La seconde « révolution » concerne la maitrise par les scientifiques de la conception et de l’assemblage « complexe de molécules aux propriétés complémentaires ». Cela ouvre la voie à « des matériaux organiques et hybrides de nouvelle génération, capables de capturer et d’utiliser la lumière de façon intelligente et performante ».
Concernant le solaire, Rémi Métivier (directeur de recherche CNRS et co-dirigeant du PEPR), explique que nous « avons besoin de résoudre des questions fondamentales telles que l’augmentation de l’efficacité, de la conversion lumineuse ou encore la durabilité des dispositifs que nous concevons ».
Minute papillon, c’est quoi des « carburants solaires » ?
Revenons quelques instants sur les carburants solaires. Engie rappelle qu’il s’agit de « combustibles fabriqués à partir de substances courantes comme l’eau et le dioxyde de carbone grâce à l’énergie de la lumière solaire, utilisée soit par récupération de chaleur soit par génération de charge électrique ».
On peut ainsi produire de l’hydrogène à partir de l’eau (H₂O), mais aussi du gaz de synthèse, du méthane/méthanol et d’autres « carburants » à partir de CO₂ ou de CO₂ + H₂O.

Dans une interview à Newstank, Catalin Miron détaille les attentes sur ce point : « L’idée est de capturer le CO₂ de l’atmosphère pour produire des carburants chimiques pouvant être stockés. Nous pensons avec LUMA pouvoir passer de l’échelle du centimètre au mètre carré pour les cellules de ces dispositifs. Ces recherches pourront aussi apporter des réponses concrètes aux besoins de la société ».