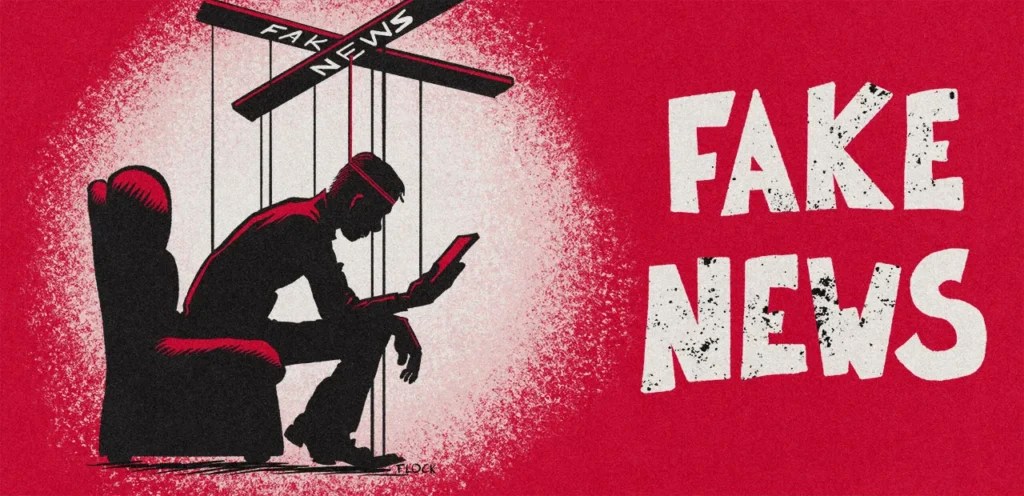China Is Shipping More Open AI Models Than US Rivals as Tech Competition Shifts
Read more of this story at Slashdot.
Read more of this story at Slashdot.
Read more of this story at Slashdot.
On m’a demandé de dégrossir un peu ce qu’il se passait chez Intel en 2025. L’impact de leur stratégie pour les années à venir. Et, gentiment, on m’a demandé de le faire avec des mots compréhensibles par « Monsieur-et-madame-tout-le-monde ». L’arrivée de Panther Lake, c’est l’occasion parfaite de tenter cet exercice difficile de défrichage technique.
On va donc commencer par le début, Panther Lake, qu’est-ce donc ? Intel est un des plus grands fabricants de processeurs au monde. C’est donc un grand industriel qui pilote de multiples entités, des dizaines d’usines de production, des centres de recherche et des antennes locales dans énormément de pays. C’est également le développeur de nombreuses gammes de produits qui sont fabriqués parfois sur de longues périodes. Pour s’y retrouver dans toute sa production, la marque emploie des noms de code qui viennent coiffer les générations de puces.
Ces noms de code sont tirés de lieux géographiques présents aux USA. En ce moment ce sont des noms de lacs. On en a eu beaucoup d’autres par le passé, Kaby Lake, Amber Lake, Whiskey Lake, Coffee Lake, Comet Lake, Lunar Lake, Arrow Lake et désormais, Panther Lake. C’est un petit lac d’eau douce situé en Floride. L’objectif de ce nom de code est donc simple. Il englobe une génération de processeurs tout en désignant également les technologies qui y sont déployées. Cela évite de se perdre dans une nomenclature de puces complexes quand on gère une société avec plus de 100 000 salariés. Cette longue suite de noms de lacs indique également une grande histoire de processeurs. C’est comme un nom de famille avec une généalogie technologique.

Intel sort d’une mauvaise passe. Sans vouloir reprendre les messages clico-alarmistes qui ont saturé les réseaux depuis des mois, la société va mal avec un énorme déficit et des pertes de parts de marché importantes. La concurrence de son eternel rival qu’est AMD – autre fabricant américain de processeurs pour PC – et l’arrivée de nouveaux concurrents majeurs ne l’a pas aidé. Ainsi Qualcomm, connu pour ses puces intégrées aux smartphones est devenu un adversaire sur le terrain des ordinateurs portables. Apple a lui aussi abandonné les puces d’Intel pour se tourner vers des processeurs développés en interne, redoutables efficaces.
Ces bouleversements de marché sont arrivés au pire moment pour Intel. La marque était en effet en train de patauger dans un bourbier technologique. Payant son manque de vision à long terme et ses faibles efforts de recherche comme d’investissements. Pendant des années, Intel n’avait plus réellement de concurrence et a relâché sa garde. Apple avait basculé ses machines sous son drapeau, AMD n’arrivait pas à proposer une alternative viable et aucun autre fabricant ne proposait de produit concurrent.

Techniquement seul sur son marché ou presque, Intel raflait tout les contrats sans chercher à se réinventer. Quand AMD réunit par miracle une « Dream Team » d’ingénieurs et invente une nouvelle architecture de processeurs baptisée Zen, Intel fait tranquillement du « sur place » depuis des années. La boite gagne beaucoup d’argent et ne voit pas pourquoi elle devrait accélérer le rythme. Dans une posture qui a si bien réussi à des marques comme Kodak ou Xerox, elle ne croit plus en une possible remontée de la concurrence et se laisse aller. Les résultats de cette stratégie consistant à maximiser ses revenus en limitant ses dépenses ne sont pas bons. De 2016 à 2018 par exemple, Intel n’arrive pas à dépasser une gravure en 14 nanomètres pendant qu’AMD annonce en 2016 ses nouveaux processeurs Zen gravés initialement en 14 nanomètres puis rapidement en 12 et enfin en 7 nanomètres. L’arrivée de puces gravées en 10 nanomètres chez Intel en 2018 est au départ assez confidentielle, ils coûtent également extrêmement cher à cause de problèmes de fiabilité qui conduisent à jeter une grosse partie de la production.
Quand en 2020 Apple décide d’abandonner Intel pour vendre ses Macs avec ses propres processeurs, la pomme change totalement de crémerie et fait graver ailleurs ses puces. Cet ailleurs vient d’un autre élément important de l’équation. Le fondeur de processeur Taiwannais qu’est TSMC. Un autre grand industriel qui n’a pas abandonné la R&D de son côté et propose à ses multiples clients des capacités de gravure sans équivalent. A tel point qu’Intel lui-même finira par faire graver des puces chez son concurrent.
Parce que passer de 14 à 7 nanomètres sur un processeur cela a l’air insignifiant mais c’est une division par deux de la taille des transistors. Autrement dit, là où vous pouviez graver 1 million de transistors avec une technologie, vous pouvez en graver environ deux fois plus avec la nouvelle. Ce gain en densité se conjugue également avec une meilleure efficacité énergétique. Autant de points qui manquent aujourd’hui à Intel qui paye aussi son manque d’investissement dans la Recherche et Développement.

A l’intérieur de la Fab 52 en Arizona
Les choses ont commencé a bouger après le départ de Brian Krzanich, PDG de la société de 2013 à 2018, qui s’était aventuré dans beaucoup de branches externes au cœur de métier de la société : objets connectés, drones, stockage et autres projets accessoires. Un intérim est mené de 2019 à 2021 après son départ. Avant qu’un nouveau PDG reprenne les rennes de la société. Si cet intérim a permis de faire le bilan des problèmes d’Intel face à la montée de la concurrence technique et commerciale, il n’y a pas eu véritablement de programme clair pour se sortir du marasme.
C’est en 2021 que les choses progressent avec le retour d’un vieux de la vieille chez Intel, Pat Gelsinger. Un ingénieur qui connait bien les problématiques de Recherche et Développement et qui met en marche d’énormes changements structurels. Il fait passer la pilule d’investissements massifs et nécessaires dans les usines de fabrication. Valide une nouvelle politique de reconcentration vers les métiers de base de la marque et remet les ingénieurs la tête dans le guidon de la recherche. Les investissements sont massifs, des usines doivent sortir de terre, les matériels de gravure de processeurs doivent évoluer, et les embauches de milliers de nouveaux ingénieurs se multiplient (pendant que d’autres branches d’emplois sont sacrifiées.) Pat fait des chèques, de gros chèques, annonce un vrai renouveau et… assume de perdre de l’argent, beaucoup d’argent. Il s’en suit des bilans qui ne sont plus au beau fixe. On est passé d’un profit net de plus de 20 milliards de dollars durant la période de 2018 à 2020 à 8 petits milliards en 2022. En 2023 l’hémmoragie continue avec 1.6 milliard de profit et en 2024 on arrive à déficit incroyable de 19 milliards de dollars.

Une des machines capable de graver en Intel 18A, un monstre hors de prix développé par ASML
Le prix à payer pour redresser la barre selon Gelsinger. Le prix qui en fait également un bon bouc émissaire. Il est donc démissionné à la fin de l’année 2024, remplacé par deux directeurs en intérim avant qu’un nouvel « héros » prenne le relais. Depuis mars 2025, Lip-Bu Tan a repris le contrôle de la société et applique peu ou prou la même politique que son prédécesseur. Il faut bien comprendre que les décisions prises aujourd’hui dans ce type d’industrie n’auront des effets que dans les années à venir. Sortir une usine de terre, capable de graver un processeur, cela demande des années de construction et souvent autant d’optimisation et de mise en place. Les architectures de processeurs annoncées aujourd’hui résultent de plans et de développement imaginés il y a fort longtemps. En informatique, nous vivons dans le passé des ingénieurs d’hier.
L’ensemble de tous ces évènements conduit à l’arrivée de Panther lake, la gamme de processeurs fraîchement annoncée par Intel. Une nouveauté technologique qui a donc une importance particulière avec un héritage des processeurs précédents et une ribambelle de nouveautés techniques cruciales pour la marque.

L’architecture Panther Lake est la suite logique des deux processeurs précédents. Meteor Lake sorti à la fin de 2023 et Lunar Lake lancé en 2024. On note d’ailleurs au passage la reprise d’un schéma d’évolution rapide chez Intel. Schéma qui avait été abandonné en 2016 sous l’ère Krzanich. Avant 2016, Intel proposait un fonctionnement basé sur une nouvelle architecture de processeur la première année et l’année suivante une optimisation de celle-ci. Cela permettait d’avoir des puces plus rapides chaque année mais cela coutait très cher avec une R&D permanente. Cette stratégie baptisée « Tick-Tock » avait été abandonnée pour une solution plus économe qui débordait sur trois années. Tick-Tock a repris ses doits chez Intel quand Pat Gelsinger a voulu renouer avec une course à la performance et l’efficacité, jugée vitale pour l’avenir de la société.
Ce Pedigree apporte l’expérience des puces passées mais aussi son lot d’innovations que l’on va retrouver en grande partie dans la nouvelle architecture technique et les méthodes de production d’Intel. La génération précédente, Lunar Lake, répondait à une problématique très importante, celle de l’efficacité énergétique. Importante pour des raisons techniques d’abord. Plus un processeur est efficace et moins il consomme d’énergie. Un détail qui permet d’avoir de meilleures autonomies, ce qui est un point crucial sur une gamme de puces mobiles. L’efficacité permet de bénéficier d’un processeur qui dégagera moins de chaleur, ce qui permet d’éviter pas mal de soucis techniques.
Le chantier de la Fab 52 d’Intel lancé en 2021
Cette recherche de la meilleure éfficacité possible est évidemment un cheval de bataille recherché par ses concurrents. Et en particulier par Apple et Qualcomm qui emploient une architecture ARM issue du monde des smartphones forcément plus économe. Les deux concurrents n’ont pas hésité a mettre en avant l’efficacité de leur puces face à Intel et AMD depuis des années. Expliquant au passage que la vieille famille de processeurs d’ordinateur était désormais dépassée.
Pour revenir dans la course, Intel a donc du largement travailler ce poste et cela a conduit la marque à… avaler son chapeau. Le fondeur a fait preuve de pragmatisme pour avancer. Comme il n’était jusque là pas capable de graver ses puces aussi finement qu’il le souhaitait, il a frappé à la porte de son principal concurrent en terme de fabrication de processeurs. TSMC, leader mondial dans la gravure de puces, a ainsi gravé les cœurs de la génération Lunar Lake. Intel n’a pas vraiment eu d’autres choix que de lui confier la tâche. La marque a ainsi pu enfin proposer des processeurs dont les cœurs, gravés en trois nanomètres par TSMC, ont pu rivaliser avec ses concurrents. Cela lui a couté cher, lui a enlèvé des bénéfices, mais lui a permis de rester dans la course.
Une course qui a permis d’arriver où nous en sommes aujourd’hui avec la gravure « 18A ».

Une pizza, un wafer Intel avec des centaines de puces
Pour prendre un exemple trivial, imaginez-vous à la tête d’une pizzeria industrielle. Vous avez plusieurs options pour fabriquer vos pizzas en quantité. Soit vous fabriquez tout vous-même et vous pouvez en retirer le maximum de bénéfices. Soit vous sous-traitez une partie et vous partagez un peu de celui-ci. Maintenant imaginez que pour une raison ou une autre votre four ne fonctionne plus. Il tourne mais quand vous le mettez en marche, sur les 500 pizzas qui entrent dans le four chaque heure, la moitié ou plus sont trop cuites. Bonnes à jeter. Un quart est pas assez cuit et ne trouve plus les mêmes débouchés vis à vis du public. Quelles solutions avez vous ? Pendant Longtemps Intel a regardé ailleurs parce qu’il n’y avait pas vraiment d’autres fabricants de Pizzas, ses Margarithas cuites en 14 nanomètres trouavaient forcément preneurs. Mais quand des concurrents sont arrivés et qu’il a voulu se remettre au niveau, c’était pour s’apercevoir d’abord que les recettes concurrentes étaient meilleures et qu’en plus, il lui était impossible d’amener le même niveau de cuisson.
Intel a donc décidé de construire une nouvelle usine de pizzas. Qui cuira vite, très finement tout en permettant les recettes appréciées par le public aujourd’hui. Cela prend du temps et pour patienter Intel a du confier la cuisson de ses Pizzas à TSMC. Le temps nécessaire à la finalisation de sa dernière usine. La Fab 52, située en Arizona.
Les puces Panther Lake sortiront donc de cette fameuse Fab 52. Et seront gravés en 18A, un processus de gravure au moins aussi bon que les 3 nanomètres de son concurrent. Autrement dit, Intel a réglé son four et promet une cuisson parfaite. Mieux que parfaite, car la marque annonce avoir réglé les problèmes de fiabilité de sa gravure et donc pouvoir accélérer la cadence de production de manière importante. On comprend l’enjeu pour le fondeur. Non seulement la marque annonce un nouveau processeur performant mais elle certifie qu’elle sera à nouveau en capacité de le produire de manière autonome, en quantité et avec peu de déchets. De quoi renouer avec les bénéfices tout en séduisant les acheteurs.

Sans vouloir trop rentrer dans les détails, graver des milliards et des milliards de transistors microscopiques sur un disque constitué d’un substrat de silicium n’est pas une chose facile. En cas de problème technique, il faut parfois jeter un nombre important de puces défectueuses, ce qui rend tout le disque – appelé wafer – déficitaire. C’est la pizza qui sort totalement brûlée du four. Il faut un certain pourcentage de processeurs exploitables pour que l’opération rapporte de l’argent. Intel indique avoir déjà atteint cette qualité de gravure sur sa fab 52.
C’est important parce qu’au-delà du nombre de wafers qui sortiront de ses chaînes, cela influe sur le prix de revient de chaque processeur et donc sur son prix de vente final. Avec 50% de déchets, chaque puce coute deux fois plus cher. Avec 1%, l’impact sur le tarif est anodin.
Intel parle désormais d’une production actuelle de 1000 à 5000 wafers chaque mois avec une montée en puissance prévue pour 2026 pour arriver à 30 000 unités. Sachant que chaque wafer représente des centaines et des centaines de processeurs, cette seule Fab 52 devient donc un enjeu stratégique important.

Autre élément central de cette architecture Panther Lake, une énorme flexibilité de fabrication. Je vais reprendre mon analogie des pizzas pour essayer de me faire comprendre. Quand vous rentrez dans une pizzeria, vous avez une carte avec un éventail de choix importants. Le pizzaiolo a devant lui des bacs contenant des ingrédients variés. Certains coutent chers et sont peu demandés, d’autres sont abordables et présents dans toutes les recettes. Vous demandez au serveur la pizza qui vous plait et il vous apporte celle-ci au bout de quelques minutes le temps de la composer Si vous voulez un supplément ananas, vous pouvez même lui réclamer. Cette possibilité de mixer les ingrédients fait le succès de la formule en permettant à la Pizzeria de varier les menus sur une même base et au client de trouver quelque chose à son goût.
Chez Intel, c’est désormais presque pareil. Un des enjeux stratégiques des développements internes de ces dernières années a été d’offrir plus de modularité aux processeurs. Les puces sont désormais construites avec des « tuiles ». Sur une base qu’on appelle le « Package » est disposée une sauce tomate spéciale : Foveros. Ce nom designe la méthode employée par Intel pour coller ensemble les différents ingrédients. Ici, différents éléments qui viendront dialoguer ensemble. On retrouve la partie calcul pour « Compute Tile » avec les fameux « cœurs » du processeur. Ces cœurs de calcul pur qui prendront en charge les opérations classiques d’un ordinateur.
On retrouve également le « GPU tile » qui correspond à la partie graphique. Et le « Platform Controller Tile » qui sert à piloter les différents éléments de votre ordinateur. Les « Filler Tile » sont juste des morceaux de silicium neutres qui vont remplir les « blancs » suivant les constructions pour éviter d’avoird des trous dans la pizza le processeur.

Le dialogue entre les différentes tuiles se fait par des ponts spécifiques pensés pour éviter tout ralentissement. Cette architecture est très interessante pour Intel car elle va permettre de construire des puces véritablement sur mesures pour ses différents clients. Le fait d’avoir des éléments séparés permet également de monter sur un processeur des tuiles différentes provenant d’usines différentes. La partie graphique des puces ne sera pas nécessairement fabriquée dans la Fab 52. Elle n’aura pas non plus forcément la même finesse de gravure.
Vous voyez où je veux en venir ? Les clients d’Intel, à savoir les constructeurs d’ordinateurs, vont pouvoir demander des solutions adaptées à tout type de profil. Un processeur entrée de gamme niveau calcul avec une puce graphique simple pour un prix très bas et une consommation minimale. Mais il sera également possible de choisir des éléments de calcul très performants avec des circuits graphiques faibles parce qu’on voudra les intégrer dans des machines disposant d’une puce graphique secondaire encore plus puissante. On pourra éalement créer plus facilement des gammes spécialisées comme les solutions qui seront déployées avec des cœurs de calculs Intel et des circuits graphiques Nvidia… Les ingrédient de base seront les mêmes et tout pourra varier suivant les besoins et les disponibilités.
Les trois tuiles sont gravées de manière différentes. La partie calcul « Compute Tile » est gravée par Intel en 18A pour plus d’efficacité. Elle est additionnée à un « GPU tile » toujours gravée par Intel mais cette fois en 3 nanomètres et la partie « Controller Tile » est toujours confiée à TSMC avec une gravure N6. Toutes sont assemblées ensuite sur la même base par Intel.

Cette possibilité permet une grande souplesse de production. En fabricant non plus des puces monobloc mais en additionnant des éléments, il est plus simple de s’adapter en fonction des besoins du marché. On pourra rediriger les différents éléments en fonction de la demande. Celle-ci n’est pas la même en fin d’année quand les gens se font plaisir pour les fêtes avec une machine haut de gamme. Qu’en début d’année scolaire où on recherche plutôt des engins plus économiques pour équiper des étudiants. A chaque fois, Intel pourra répondre au mieux des besoins.

Pour améliorer encore cette proposition, les puces seront déclinées suivant des déclinaisons internes déjà employées dans les puces de générations précédentes. Trois type de cœurs seront proposés. On retrouve des cœurs P pour Performants. Très rapides, très puissants mais également plus gourmands en énergie. Des cœurs E ou Efficients qui proposent moins de puissance de calcul mais consommeront également moins de batterie. Et enfin des cœurs LPE à très très basse consonsommation. Les différents cœurs peuvant se mélanger en de multiples combinaisons pour former des tuiles jouant sur la performance brute, une puissance plus équilibrée ou ayant une meilleure autonomie.

Pour le moment trois processeur Panther Lake sont annoncés. Tous trois étant dérivés de la même base mais architecturés de manière différente. La nouvelle gamme Panther Lake promet, grâce entre autre à cette finesse de gravure 18A d’Intel, des gains de 10% sur la puissance établie par un seul coeur et pouvant aller jusqu’à 50% en additionnant plusieurs d’entre eux. Il faut bien comprendre que cette évolution en performances se calcule à consommation égale. Le chiffre est donc assez impressionnant. Mais elle promet surtout des architectures pouvant s’agencer de manière beaucoup plus souple.

Le premier est un huit cœurs coposé de quatre cœurs P et quatre cœurs LPE. Il est associé au NPU5 maison qui développe 50 TOPS, propose 8 Mo de cache et prend en charge les mémoire vive DDR5 et LPDDR5. Sa gravure est donc en Intel 18A et il est asscocié à des éléments importants. D’abord un circuit graphique Intel Xe3 avec quatre cœurs Xe et quatre unités de Raytracing gravé en Intel 3. Son controleur est très complet avec de nombreuses prises en charges natives : Wi-Fi7 et Bluetooth 6.0 pour le sans fil, jusqu’à quatre lignes Thunderbolt 4.0 offrant de larges possibilutés de connectiques, deux lignes USB 3.2 et huit en USB 2.0. Ainsi que douze lignes PCIe : huit en PCIe Gen4 et quatre en PCIe Gen5. Ces éléments sont très important pour la prise en charge de solutions comme du stockage rapide, un circuit graphique secondaire entre autres choses.

La seconde puce est donc un dérivé logique de la première. Avec seize cœurs composés de quatre cœurs P, huit cœurs E et quatre cœurs LPE. Intela juste ajouté les cœurs E dans l’équation. Le reste ne change pas beaucoup, la vitesse de la mémoire vive grimpe un peu plus, le nombre de lignes PCIe augmente pour passer à vingt avec toujours huit PCIe Gen4 mais désormais 12 PCIe Gen5. La partie graphique ne bouge pas, c’est litteralement la même « Tile » qui est posée sur la puce.

Enfin, la puce la plus haut de gamme reprend exactement la mêem tuile de calcul que la précédente, sa mémoire vive grimpe plus haut et uniquement en modules soudés sur la carte mère. Son controlleur ne bouge pas non plus mais sap aprtie graphique évolue nettement puisqu’on passe à un Xe3 composé non plus de quatre mais de douze cœurs Xe avec autant d’unités de Raytracing. On note au passage qu’intel ne sera plus à la manoeuvre pour gravé ce circuiot qui sera confié à un prestataire externe.

Cette méthode de construction de puce avec de multiples cœurs plus ou moins performants permet de gagner en autonomie. La méthode employée ici par Panther Lake est issue directement de la génération précédente. On retrouve une méthode de traitement des tâches baptisée ‘Thread Director ». L’idée est simple, le plus petit cœur essaye de se débouiller du mieux qu’il peu avec une tâche avant de passer le relais à un cœur plus gros si il arrive au bout de ses capacités de traitement.
Imaginons que le système veuille décoder un flux vidéo, aussi lourd soit-t-il, pris en charge par la partie vidéo de la puce. Le boulot consiste a faire transiter le fichier vers le circuit graphique, rien de plus. Pas la peine de réveiller un cœur performant pour cette tâche, un petit cœur LPE s’en sortira très bien. Si il s’agit de faire une seconde tâche basique en parrallèle, un second cœur du même type sera réveillé. Si les choses se corsent, par exemple pour l’ouverture d’un logiciel plus lourd, on pourra réveiller l’étage du dessus. Les cœurs « E » voir même les cœurs « P ». Puis le système les « éteindra » quand le programme sera alancé et dans l’attente d’une tâche.
Cette méthode de cœurs multiples est clairement inspirée du monde des puces ARM de nos smartphones. Elle va permettre d’économiser énormément d’énergie en évitant de réveiller des cœurs surpuissant consommant beaucoup pour des tâches qui n’occuperont quelques dixièmes de leur puissance. Pour améliorer encore cette gestion de l’énergie, les puces Panther Lake dialogueront directement avec les systèmes d’exploitation.
Chaque puce propfitera d’une gestion de profil énergétique codée directement dans leur design. Baptisée « Intel Intelligence Experience Optimizer » elle permettra de se positionner suivant plusieurs scénarios d’usages avec un mode équilibré par défaut. Le fondeur promet à la fois de meilleures performances au global mais aussi une meilleure autonomie. Résultat des courses, une consommation considérablement réduite : 40% de moins face à la génération Arrow Lake . 10% de moins que Lunar Lake. Autant de points gagnés pour l’autonomie des machines.

On comprend à la lumière de tout cela que Panther Lake est plus qu’une nouvelle génération de processeur pour Intel. C’est à la fois un moyen de se relancer, le résultat d’efforts considérables autant techniques que financiers mais également un pari pour son avenir. La marque a ouvert ses services de fonderie à des constructeurs tiers depuis un moment et compte bien sur sa technologie 18A pour les attirer.
Plus elle aura de nouveaux clients, plus il sera simple de rentabiliser ses très lourds investissements. Il faut donc impérativement briller en terme de performances et tenir des cadences de productions autant excellentes en rendement qu’en efficacité pour l’année 2026.
Si vous êtes néophyte et que vous avez tenu jusque là, bravo. J’ai tenté de vous faire passer un maximum d’informations de manière la plus simple possible. Malheureusement il vient toujours un moment où il faut attaquer un peu de technique. Et pour parler des architectures des puces il n’existe pas vraiment de moyens de faire autrement. Retenez donc juste que les puces sont attendues pour 2026 et que nous devrions avoir l’étendue des modèles proposés, leur nomenclature dévoilée et leurs tarifs annoncés en janvier mors du CES 2026.

Outre les éléments liés à ses techniques de gravure dont je vous ai déjà parlé il y a peu dans ce billet précédent, Intel annonce de nouvelles générations de cœurs dans ses puces.

Les coeurs « P » ne sont plus les mêmes que les précédents. On bascule ici sur une génération baptisée Cougar Cove1. Ils ont très logiquement été pensés dès leur conception pour bénéficier des avantages de la technologie de gravure 18A.
Si Intel n’a pas fait toute la lumière sur ces cœurs, la société a confirmé qu’il s’agit ici surtout d’une optimisation technique plutôt que d’une révolution. Des éléments intéressants sont pourtant à l’oeuvre. Comme le recours à une technologie prédictive pour adapter la demande de ressources aux besoins du système. Une solution de prédiction qui permet d’optimiser le rendement des puces. Du côté de la mémoire par exemple, ces cœurs sont capables d’anticiper des évènements et donc d’y répondre plus efficacement. Le fait de bénéficier d’une gravure plus fine semble également améliorer la vitesse d’execution de ces anticipations.
Un des gros enjeu de développement depuis Lunar Lake semble être dans ces méthodes predictives qui permettent de « préparer » des calculs avant qu’ils narrivent et donc d’y répondre immédiatement au moment où le programme sollicite la puce.

Les cœurs E et LPE sont désormais reconnus sous le nom de « Darkmont »2 même si il s’agit là encore d’évolutions de la génération « Skymont » des puces Lunar Lake précédentes. Là encore il a surtout s’agit d’aumenter les capacités a anticiper les besoins logiciels a venir. autre méthode ré-employée ici et descendante directe des générations précédentes, les nanocodes. Il s’agit de recettes toutes faites permettant aux processeur de résoudre des calculs complexes fréquemment utilisés sans réveiller réellement la totalité du cœur. Cela a évidemment un impact sur la consommation et l’efficacité du processeur. Darkmont est censé avoir plus de « recettes » de nanocodes et les effectuer plus effiacement. Sachant que certains programmes peuvent en aligner des quantités impressionnantes, l’impact est d’autant plus grand.

Autre élément intéressant dans cette nouvelle équation, la partie graphique. Depuis pusieurs années, Intel redouble d’efforts sur ce poste pendant longtemps laissé en jachère. La marque a compté sur le volume de ses ventes pour facturer un circuit graphique de base à ses clients sans chercher a en faire un véritable argument d’achat. Avec peu de concurrence, elle se plaisait à dire que c’était le premier fabricant de circuits graphiques PC au monde. Ce qui était le cas de fait puisque chaque processeur livré comprenait un de ses circuit graphique.
L’arrivée de solutions concurrentes chez AMD a reveillé la marque de sa torpeur. Les puces concurrentes, équipées de cœurs graphiques très performants, ont obligé Intel a développer des puces plus nerveuses. Plus adaptées aux besoin d’un ordinateur moderne. Avec des compétences en décodage vidéo Ultra Haute défitinion et des capacités en rendu 2D tout à fait satisfaisantes. Plus récemment Intel a proposé des puces aux performances 3D plus sérieuses. Panther Lake signe l’apparition de la toute dernière gamme de cœurs graphique de ces nouvelles générations. Gamme qui a sérieusement musclé son jeu. Panther Lake est l’occasion d’introduire le nouveau iGPU Xe3 (nom de code Celestial) qui apporte de sérieuses améliorations à un socle technique déjà très solide.
Selon les configurations, Xe3 pourra proposer jusqu’à 12 cœurs et 12 unités de ray tracing avec un cache L2 jusqu’à 16 Mo. Des spécifications qui vont de pair avec des nouveautés très prometteuses.

Des cœurs « Xe3 » qui pourront s’additionner pour atteindre 12 unités de calcul associées à des fonctions avancées de gestion de rendu et des modes de fonctionnement originaux. Ici Intel n’hésite pas a annoncer une augmentation de ses performances pouvant atteindre 50%. De quoi basculer des processeurs Lunar Lake de la génération actuelle proposant déjà d’excellents servives à des puces capables d’afficher programmes et jeux très confortablement.

Cette évolution va de pair avec une pratique de plus en plus répandue chez les développeurs de puces graphiques. La génération d’image par Intelligence Artificielle. Une technique qui consiste a laisser la puce « générer » plusieurs images intermédiaires entre les éléments vraiment calculés par le processeur. Imaginez vous devoir dessiner une scène pour un dessin-animé. La première image vous demandera beaucoup de ressources. Mais pour rendre la transition fluide vers la fin d’un mouvement dans une scène il faudra dessiner énormément d’étapes transitoires. L’idée est de ne calculer entièrement que les étapes immportantes et laisser un algorithme enrainé spécifiquement pour chaque jeu imaginer les étapes inermédiaires. Dépendant d’un autre mode de calcul, ces étapes demandent moins de ressources à la puce. Le rendu final est plus fluide avec plus d’images affichées par seconde.
Derniers éléments posés sur la grosse pizza d’Intel, d’abord un processeur Neuronal (ou NPU) affichant 50 TOPS en FP8. Ces solutions ultra spécialisées dans les calculs d’IA seront directement intégrées dans l’ensemble. Ensuitre un IPU, une puce construite pour prendre en charge des capteurs vidéo, qui saura piloter trois caméras en parrallèle. Tout en leur appliquant différents traitements en temps réel comme la réduction de bruit en basse lumière par exemple.

Intel joue ici très gros. Les puces Lunar Lake vont devoir séduire les fabricants qui ne manqueront probablement pas de répondre à l’appel. Il faut s’attendre à une annonce massive de nouveaux materiels pour le CES en janvier prochain. Pour le moment les chiffres annoncés s’appuient sur les puces de la marque. Positionnant
Panther Lake devant Lunar Lake. Le vrai pari pour Intel sera de trouver les justes équilibres.
Ménager la performance et l’autonomie, proposer des capacités d’affichages suffisantes pour cette gamme de processeurs tout ayant la possibilité de s’asapter avec d’autres recettes. Et on pense évidemment au duo Intel / Nvidia qui se profile. Et séduire sur tous les autres postes : multimédia, IA, autonomie, chauffe mais aussi services avec l’intégration de fonctions comme le Wi-Fi7 et Bluetooth 6.0 par défaut, la possiblité d’exploiter des stockages ultra rapides, la prise en charge de conenctique avancée.
Le fondeur a réussi a redresser la barre et a mener sa barque loin des récifs. Reste a la piloter avec les capitaines que sont les marques pour qu’ils délivrent des produits bien calibrés. Le pire pour cette génération serait qu’elle soit traitée comme la précédente, sans l’optimisation nécessaire pour en tirer le meilleur parti.
Panther Lake, mieux comprendre le futur mobile d’Intel © MiniMachines.net. 2025
![[Édito] Arrêtons de compter la puissance de calcul des GPU en GW, ça ne veut rien dire !](https://next.ink/wp-content/uploads/2025/10/Gloubiboulga.webp)
Coup sur coup, AMD, OpenAI et NVIDIA ont décidé de communiquer sur des GW (giga watts) pour parler des GPU dédiée à l’intelligence artificielle. Problème, cela ne donne absolument aucune indication sur les performances attendues/espérées. Un gros chiffre pour faire parler (et ça marche), sans rien de concret.
Il y a trois semaines, NVIDIA et OpenAI s’engageaient réciproquement : le premier investit jusqu’à 100 milliards de dollars dans le second, tandis qu’OpenAI s’engage à déployer « au moins 10 GW de systèmes NVIDIA ». Greg Brockman, cofondateur et président d’OpenAI, se disait « impatient de déployer 10 GW de puissance de calcul ». La semaine dernière, rebelote avec AMD et OpenAI cette fois-ci. Pas de détail sur le volet financier, mais la promesse qu’« OpenAI va déployer 6 GW de GPU AMD ».
Pourquoi les trois comparses parlent-ils de GW pour évoquer une puissance de calcul ? Qu’est-ce que cela veut dire en termes de performances ? Qu’est-il possible de faire avec cette débauche de watts ?
 Depuis quelques jours, les marques et fabricants de cartes mères se donnent à des communiqués affirmant que les processeurs de la prochaine génération animés par des cœurs Zen 6 seront compatibles avec les cartes mères actuelles AM5. Quant on sait qu'AMD certifie cela depuis des mois, afin de rassur...
Depuis quelques jours, les marques et fabricants de cartes mères se donnent à des communiqués affirmant que les processeurs de la prochaine génération animés par des cœurs Zen 6 seront compatibles avec les cartes mères actuelles AM5. Quant on sait qu'AMD certifie cela depuis des mois, afin de rassur...
Read more of this story at Slashdot.
Read more of this story at Slashdot.
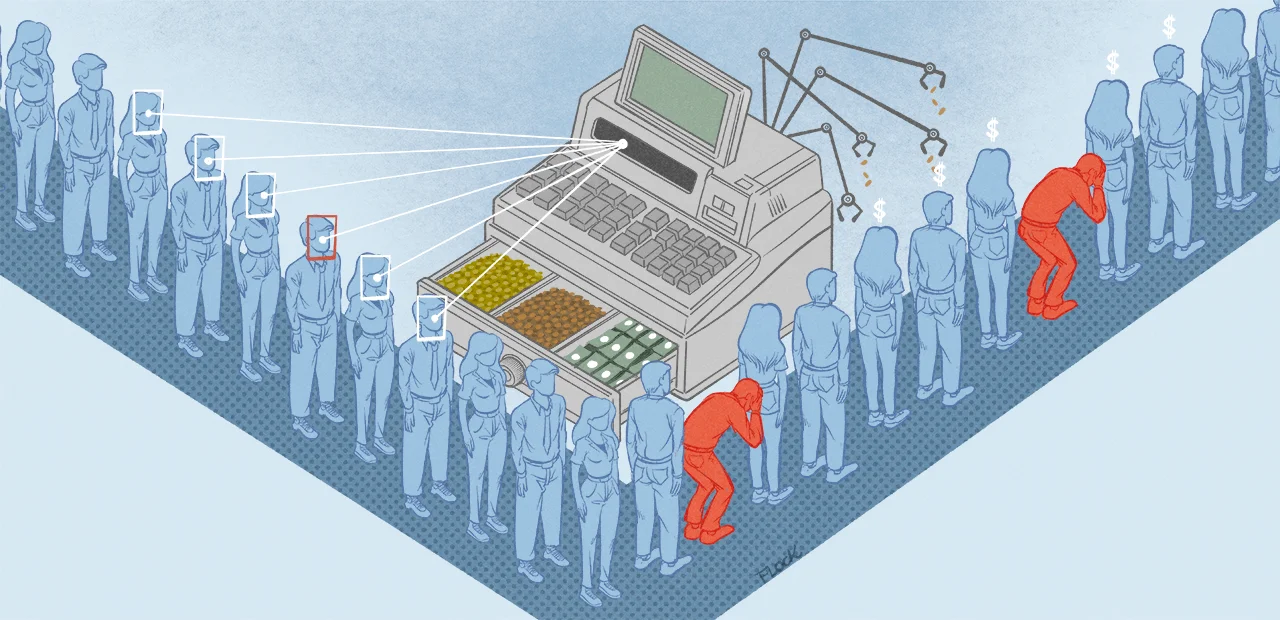
Un Français sur deux parvient à réaliser ses démarches administratives en ligne sans chercher d’aide, selon un rapport de la Défenseure des droits.
En 2014, la France se classait première au classement des pays disposant des meilleurs services publics en ligne. Onze ans plus tard, l’expansion de ce mode de relation entre la population et les services publics se traduit par de vrais casse-têtes, et un accès variable aux droits, alerte la Défenseure des droits.
Le nombre de difficultés signalées par les internautes a même augmenté entre 2016 et 2024, selon un rapport publié ce 13 octobre par l’institution. L’an dernier, près de deux répondants sur trois (61 % des interrogés) témoignaient avoir rencontré des difficultés dans leurs relations aux administrations, contre 39 % en 2016. Surtout, moins d’un sur deux parvient à effectuer ses démarches administratives en ligne sans se faire aider.
Pour mener cette nouvelle édition de son enquête sur l’accès aux droits (la première remonte à 2016), les services de la Défenseure de droits ont réalisé avec des équipes du CNRS 5 030 entretiens, auprès d’un panel représentatif de la population âgée de 18 à 79 ans habitant en France métropolitaine.
Le but : comprendre les difficultés rencontrées lors de la réalisation de démarches administratives, celles rencontrées au moment de résoudre un problème avec une administration ou un service public, et les cas dans lesquels les personnes renoncent à faire valoir un droit.
Constat principal : les échanges avec les services publics sont complexes, notamment lorsqu’ils sont réalisés en ligne, et le problème concerne tous les publics. Cadres, diplômés de master ou plus, personnes de nationalité française depuis la naissance, tous ces profils qui rencontrent habituellement moins de problèmes dans leurs échanges avec l’administration rapportent davantage de difficultés en 2024 qu’en 2016.
Pour autant, 31 % des ouvriers et employés et 33 % des personnes en difficultés financières rencontrent fréquemment des difficultés, ce qui en fait des populations plus exposées aux problèmes de relation avec les services publics que les autres. Pour les échanges spécifiquement réalisés en ligne, 36 % des interrogés cherchent de l’aide, 8 % déclarent avoir besoin d’être accompagnés et 7 % évitent de réaliser des démarches en ligne, par choix.

Ces enjeux de facilité d’usage des démarches numériques se traduisent par une forte corrélation avec la facilité à réaliser des démarches administratives de manière générale.
Pour ce qui est de la gestion de problèmes spécifiques rencontrés avec l’administration, la Défenseure des droits constate que le nombre de difficultés déclarées a baissé, de 54 % en 2016 à 42 % en 2024. Cela dit, en 2024, quatre usagers interrogés sur dix déclarent tout de même avoir rencontré au moins un problème avec un service public. Parmi ces enjeux sont cités, par ordre de fréquence, la difficulté à contacter quelqu’un pour échanger ou obtenir un rendez-vous ; à obtenir des informations fiables ; la demande répétée de pièces justificatives ; l’absence de réponse ou les réponses tardives. Près de 2 personnes sur 5 citent aussi des problématiques (39 %) d’erreur de traitement.
Face à un ou plusieurs des cas tout juste cités, l’essentiel des répondants (88 %) tente de re-contacter le service public concerné. Dans ces cas-là, les deux tactiques les plus plébiscités consistent à éviter l’outil numérique : 55 % essaient d’appeler et 33 % de se déplacer directement dans les bureaux de l’administration concernée. Les taux de résolution de problème varient selon la méthode employée – le déplacement permet une résolution dans 72 % des cas, quand le courrier le permet dans seulement 56 % des cas. Il varie aussi, entre autres, selon la facilité d’usage des services numériques : 68 % de ceux qui savent y recourir parviennent à résoudre leurs problèmes, contre 58 % de ceux qui ne le savent pas.
Conséquence de ces diverses embûches, près d’une personne sur quatre déclarent avoir déjà renoncé à un droit auquel elle aurait pu prétendre, devant la complexité de la démarche pour l’obtenir. Les personnes qui rencontrent des difficultés ont deux fois plus de chances de renoncer à leur démarche administrative que celles qui n’en rencontrent pas.
La Défenseure des droits souligne l’ambivalence de la dématérialisation des services publics qui, s’ils facilitent certaines interactions, se transforment aussi en obstacle pour celles et ceux qui préfèrent les interactions directes avec l’administration.
Pour leur apporter à de l’aide, la France a lancé en 2021 le dispositif des « conseillers numériques », 4 000 personnes employées partout sur le territoire pour aider celles et ceux qui en ont besoin à réaliser leurs diverses démarches en ligne. Mais le budget 2025 avait déjà conduit à une réduction du nombre de postes, une tendance qui pourrait se poursuivre.
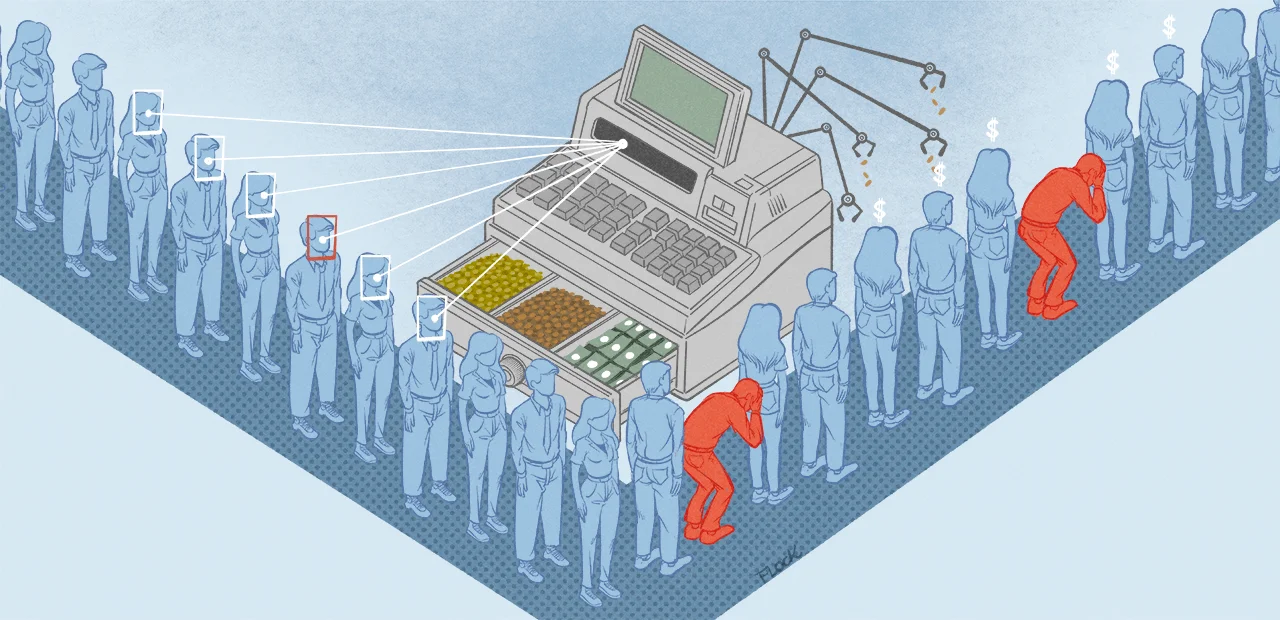
Un Français sur deux parvient à réaliser ses démarches administratives en ligne sans chercher d’aide, selon un rapport de la Défenseure des droits.
En 2014, la France se classait première au classement des pays disposant des meilleurs services publics en ligne. Onze ans plus tard, l’expansion de ce mode de relation entre la population et les services publics se traduit par de vrais casse-têtes, et un accès variable aux droits, alerte la Défenseure des droits.
Le nombre de difficultés signalées par les internautes a même augmenté entre 2016 et 2024, selon un rapport publié ce 13 octobre par l’institution. L’an dernier, près de deux répondants sur trois (61 % des interrogés) témoignaient avoir rencontré des difficultés dans leurs relations aux administrations, contre 39 % en 2016. Surtout, moins d’un sur deux parvient à effectuer ses démarches administratives en ligne sans se faire aider.
Pour mener cette nouvelle édition de son enquête sur l’accès aux droits (la première remonte à 2016), les services de la Défenseure de droits ont réalisé avec des équipes du CNRS 5 030 entretiens, auprès d’un panel représentatif de la population âgée de 18 à 79 ans habitant en France métropolitaine.
Le but : comprendre les difficultés rencontrées lors de la réalisation de démarches administratives, celles rencontrées au moment de résoudre un problème avec une administration ou un service public, et les cas dans lesquels les personnes renoncent à faire valoir un droit.
Constat principal : les échanges avec les services publics sont complexes, notamment lorsqu’ils sont réalisés en ligne, et le problème concerne tous les publics. Cadres, diplômés de master ou plus, personnes de nationalité française depuis la naissance, tous ces profils qui rencontrent habituellement moins de problèmes dans leurs échanges avec l’administration rapportent davantage de difficultés en 2024 qu’en 2016.
Pour autant, 31 % des ouvriers et employés et 33 % des personnes en difficultés financières rencontrent fréquemment des difficultés, ce qui en fait des populations plus exposées aux problèmes de relation avec les services publics que les autres. Pour les échanges spécifiquement réalisés en ligne, 36 % des interrogés cherchent de l’aide, 8 % déclarent avoir besoin d’être accompagnés et 7 % évitent de réaliser des démarches en ligne, par choix.

Ces enjeux de facilité d’usage des démarches numériques se traduisent par une forte corrélation avec la facilité à réaliser des démarches administratives de manière générale.
Pour ce qui est de la gestion de problèmes spécifiques rencontrés avec l’administration, la Défenseure des droits constate que le nombre de difficultés déclarées a baissé, de 54 % en 2016 à 42 % en 2024. Cela dit, en 2024, quatre usagers interrogés sur dix déclarent tout de même avoir rencontré au moins un problème avec un service public. Parmi ces enjeux sont cités, par ordre de fréquence, la difficulté à contacter quelqu’un pour échanger ou obtenir un rendez-vous ; à obtenir des informations fiables ; la demande répétée de pièces justificatives ; l’absence de réponse ou les réponses tardives. Près de 2 personnes sur 5 citent aussi des problématiques (39 %) d’erreur de traitement.
Face à un ou plusieurs des cas tout juste cités, l’essentiel des répondants (88 %) tente de re-contacter le service public concerné. Dans ces cas-là, les deux tactiques les plus plébiscités consistent à éviter l’outil numérique : 55 % essaient d’appeler et 33 % de se déplacer directement dans les bureaux de l’administration concernée. Les taux de résolution de problème varient selon la méthode employée – le déplacement permet une résolution dans 72 % des cas, quand le courrier le permet dans seulement 56 % des cas. Il varie aussi, entre autres, selon la facilité d’usage des services numériques : 68 % de ceux qui savent y recourir parviennent à résoudre leurs problèmes, contre 58 % de ceux qui ne le savent pas.
Conséquence de ces diverses embûches, près d’une personne sur quatre déclarent avoir déjà renoncé à un droit auquel elle aurait pu prétendre, devant la complexité de la démarche pour l’obtenir. Les personnes qui rencontrent des difficultés ont deux fois plus de chances de renoncer à leur démarche administrative que celles qui n’en rencontrent pas.
La Défenseure des droits souligne l’ambivalence de la dématérialisation des services publics qui, s’ils facilitent certaines interactions, se transforment aussi en obstacle pour celles et ceux qui préfèrent les interactions directes avec l’administration.
Pour leur apporter à de l’aide, la France a lancé en 2021 le dispositif des « conseillers numériques », 4 000 personnes employées partout sur le territoire pour aider celles et ceux qui en ont besoin à réaliser leurs diverses démarches en ligne. Mais le budget 2025 avait déjà conduit à une réduction du nombre de postes, une tendance qui pourrait se poursuivre.
Read more of this story at Slashdot.
 Début septembre, Valve déposait le nom Steam Frame. Deux hypothèses circulaient alors : une console de salon, ou un casque de réalité virtuelle connu jusqu’ici sous le nom de code Deckard... [Tout lire]
Début septembre, Valve déposait le nom Steam Frame. Deux hypothèses circulaient alors : une console de salon, ou un casque de réalité virtuelle connu jusqu’ici sous le nom de code Deckard... [Tout lire] 
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine reprend de plus belle. Désormais, 12 des 17 terres rares, indispensables à de nombreux produits numériques, sont sous le coup d’une licence d’exportation chinoise. En réponse, Donald Trump augmente de 100 % les droits de douane.
Dans les smartphones modernes, on retrouve « plus de 60 matériaux, sur les 103 éléments du tableau périodique de Mendeleïev », expliquait il y a quelques années le CEA. Il y a des matériaux stratégiques pour un pays (indispensables à la politique économique, énergétique et à la défense) et d’autres critiques (risque particulièrement élevé de pénurie d’approvisionnement).
Une bonne partie de ces matériaux n’est disponible que dans les sols d’une poignée de pays. Suivant les cas, la Chine est incontournable, ou bien l’Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, les États-Unis, le Brésil, etc. La Chine détient par exemple 86 % des terres rares, 89 % du magnésium, 80 % du bismuth, gallium et germanium.
Les terminaux mobiles ne sont pas les seuls concernés, des terres rares sont aussi utilisées dans les véhicules électriques, les moteurs, les appareils médicaux (IRM), les casque audio, les radars, les éoliennes, le photovoltaïque, la défense…
Être un acteur incontournable de l’approvisionnement en matériaux nécessaires au numérique donne un important levier de pression. La Chine l’a déjà actionné à plusieurs reprises par le passé. En avril 2025, le pays « a commencé à imposer des restrictions à l’exportation sur 7 des 17 terres rares » : samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutétium, scandium et yttrium.
De sept initialement, les exportations de douze d’entre eux sont désormais « restreints, depuis que le ministère du Commerce en a ajouté cinq – holmium, erbium, thulium, europium et ytterbium – aux côtés d’autres matériaux », explique Reuters.

Désormais, les entreprises étrangères dont « le produit final contient ou est fabriqué avec de l’équipement ou des matériaux chinois » devrait obtenir une licence d’exportation. Ces règles s’appliquent « même si la transaction ne comprend pas d’entreprises chinoises », expliquent nos confrères. Elles seront applicables à partir du 8 novembre.
Une réponse de la Chine aux États-Unis qui intensifie régulièrement ses restrictions d’exportation de semi-conducteur (les puces physiques utilisées dans les ordinateurs et autres machines) vers la Chine. La dernière action en date des États-Unis a tout juste une semaine. NVIDIA, champion actuel des puces dédiées à l’intelligence artificielle, est au milieu de cette guerre.
La réaction de Donald Trump ne s’est pas faite attendre. Vendredi, le président des États-Unis a annoncé une hausse de 100 % des droits de douane sur les produits chinois. Ce taux « vient s’ajouter aux 30 % déjà appliqués à l’ensemble des produits chinois depuis mai », explique l’AFP via Le Monde. « Certains droits de douane pourraient alors atteindre à 150 %, voire 200 % selon les secteurs », ajoutent nos confrères.
Tous les acteurs mondiaux cherchent à limiter au maximum leur dépendance à des pays extérieurs, que ce soit pour se fournir en matériaux qu’en produits ou en logiciels. La Chine développe ses propres puces et système d’exploitation, les États-Unis cherchent des sources d’approvisionnement (notamment en Ukraine).
L’Europe se cherche aussi de nouveaux partenaires, mais souhaite qu’ils respectent « des standards élevés en matière de durabilité et de droits humains ». Des partenariats ont déjà été signés par la Commission européenne avec de nombreux pays : Canada, Ukraine, Kazakhstan, Namibie, Argentine, Chili, Congo, Zambie, Groenland, Rwanda, Ouzbékistan, Australie et la Serbie.

Les lobbys internationaux du cinéma espèrent terrasser « l’hydre » du streaming en utilisant la justice indienne. Celle-ci leur permet de bloquer les domaines indiens des sites illégaux mais elle demande aussi aux bureaux d’enregistrement de nom de domaines situé au-delà des frontières de son pays de suspendre les noms de domaine ciblés. Une mesure qui n’est pas forcément si efficace que ça.
Dans une décision prise le 23 septembre dernier, la justice indienne a émis une injonction concernant la protection d’œuvres protégées par le copyright détenus par plusieurs multinationales, dont Universal, mais aussi cinq autres membres de la Motion Picture Association MPC et/ ou de l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), deux lobbys importants d’Hollywood. Trois autres plaignants font partie de la Copyright Overseas Promotion Association, un lobby du cinéma coréen cette fois.
Les studios étasuniens et coréens semblent essayer de vouloir passer par la justice indienne pour imposer la fermeture de sites et aussi couper plus rapidement les têtes de l’hydre du streaming. S’ils sont déjà passé par la justice américaine pour faire ce genre d’action, les décisions étaient trop lentes et peu efficaces.

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine reprend de plus belle. Désormais, 12 des 17 terres rares, indispensables à de nombreux produits numériques, sont sous le coup d’une licence d’exportation chinoise. En réponse, Donald Trump augmente de 100 % les droits de douane.
Dans les smartphones modernes, on retrouve « plus de 60 matériaux, sur les 103 éléments du tableau périodique de Mendeleïev », expliquait il y a quelques années le CEA. Il y a des matériaux stratégiques pour un pays (indispensables à la politique économique, énergétique et à la défense) et d’autres critiques (risque particulièrement élevé de pénurie d’approvisionnement).
Une bonne partie de ces matériaux n’est disponible que dans les sols d’une poignée de pays. Suivant les cas, la Chine est incontournable, ou bien l’Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, les États-Unis, le Brésil, etc. La Chine détient par exemple 86 % des terres rares, 89 % du magnésium, 80 % du bismuth, gallium et germanium.
Les terminaux mobiles ne sont pas les seuls concernés, des terres rares sont aussi utilisées dans les véhicules électriques, les moteurs, les appareils médicaux (IRM), les casque audio, les radars, les éoliennes, le photovoltaïque, la défense…
Être un acteur incontournable de l’approvisionnement en matériaux nécessaires au numérique donne un important levier de pression. La Chine l’a déjà actionné à plusieurs reprises par le passé. En avril 2025, le pays « a commencé à imposer des restrictions à l’exportation sur 7 des 17 terres rares » : samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutétium, scandium et yttrium.
De sept initialement, les exportations de douze d’entre eux sont désormais « restreints, depuis que le ministère du Commerce en a ajouté cinq – holmium, erbium, thulium, europium et ytterbium – aux côtés d’autres matériaux », explique Reuters.

Désormais, les entreprises étrangères dont « le produit final contient ou est fabriqué avec de l’équipement ou des matériaux chinois » devrait obtenir une licence d’exportation. Ces règles s’appliquent « même si la transaction ne comprend pas d’entreprises chinoises », expliquent nos confrères. Elles seront applicables à partir du 8 novembre.
Une réponse de la Chine aux États-Unis qui intensifie régulièrement ses restrictions d’exportation de semi-conducteur (les puces physiques utilisées dans les ordinateurs et autres machines) vers la Chine. La dernière action en date des États-Unis a tout juste une semaine. NVIDIA, champion actuel des puces dédiées à l’intelligence artificielle, est au milieu de cette guerre.
La réaction de Donald Trump ne s’est pas faite attendre. Vendredi, le président des États-Unis a annoncé une hausse de 100 % des droits de douane sur les produits chinois. Ce taux « vient s’ajouter aux 30 % déjà appliqués à l’ensemble des produits chinois depuis mai », explique l’AFP via Le Monde. « Certains droits de douane pourraient alors atteindre à 150 %, voire 200 % selon les secteurs », ajoutent nos confrères.
Tous les acteurs mondiaux cherchent à limiter au maximum leur dépendance à des pays extérieurs, que ce soit pour se fournir en matériaux qu’en produits ou en logiciels. La Chine développe ses propres puces et système d’exploitation, les États-Unis cherchent des sources d’approvisionnement (notamment en Ukraine).
L’Europe se cherche aussi de nouveaux partenaires, mais souhaite qu’ils respectent « des standards élevés en matière de durabilité et de droits humains ». Des partenariats ont déjà été signés par la Commission européenne avec de nombreux pays : Canada, Ukraine, Kazakhstan, Namibie, Argentine, Chili, Congo, Zambie, Groenland, Rwanda, Ouzbékistan, Australie et la Serbie.

On commence la semaine avec un ordinateur portable qui est réellement portable, mais qui pour autant embarque du gros, du lourd. Ce jour, nous testons le ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR qui embarque un Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5070 Ti, 32 Go de mémoire, 1 To de SSD et une dalle 14 pouces OLED 2880 x 1800 120 Hz. Il est à découvrir ici même : Test portable ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR ou en cliquant sur la source. […]
Lire la suiteRead more of this story at Slashdot.
Robby Starbuck recourt à sa plateforme chez Meta pour diffuser de la désinformation sur les récentes tueries qui ont secoué les États-Unis, les personnes transgenres, les vaccins et divers autres événements d’actualité.
Il avait été nommé mi-août à ce poste, après avoir porté plainte contre Meta pour le fonctionnement de son robot conversationnel Meta AI. Ce dernier avait en effet diffusé des informations « manifestement fausses et diffamatoires », selon la plainte de Starbuck, selon lesquelles ce dernier aurait participé à l’attaque du Capitole à Washington le 6 janvier 2021.
Depuis qu’il a été nommé conseiller de Meta sur la question des bais, cet influenceur connu pour son positionnement anti-diversité, équité et inclusion a diffusé diverses théories fausses ou trompeuses. Il a notamment cherché à plusieurs reprises à lier des attentats récents au parti démocrate, ou amplifier des théories conspirationnistes sur les vaccins.
Pour la cofondatrice du Global Project against Hate and extremism Heidi Birch, interrogée par the Guardian, la nomination de Starbuck à un tel rôle est un problème en soi, dans la mesure où ce dernier « promeut des mensonges et de l’extrémisme ». Pour le vice-président de Human Rights Campaign Foundation, Starbuck participe à la promotion d’un « agenda anti-LGBTQ dangereux ».
Auprès du média britannique, ce dernier décrit son rôle comme « simple » : dédié à « rendre l’IA sûre pour tout le monde, quelles que soient leurs positions. Ce que vous essayez vraiment de faire ici ressemble à de la cancel culture et à de l’activisme déguisés en journalisme, et je ne vais pas me cacher parce que je partage les mêmes opinions que le parti politique qui a remporté le vote populaire il y a moins d’un an aux États-Unis. »