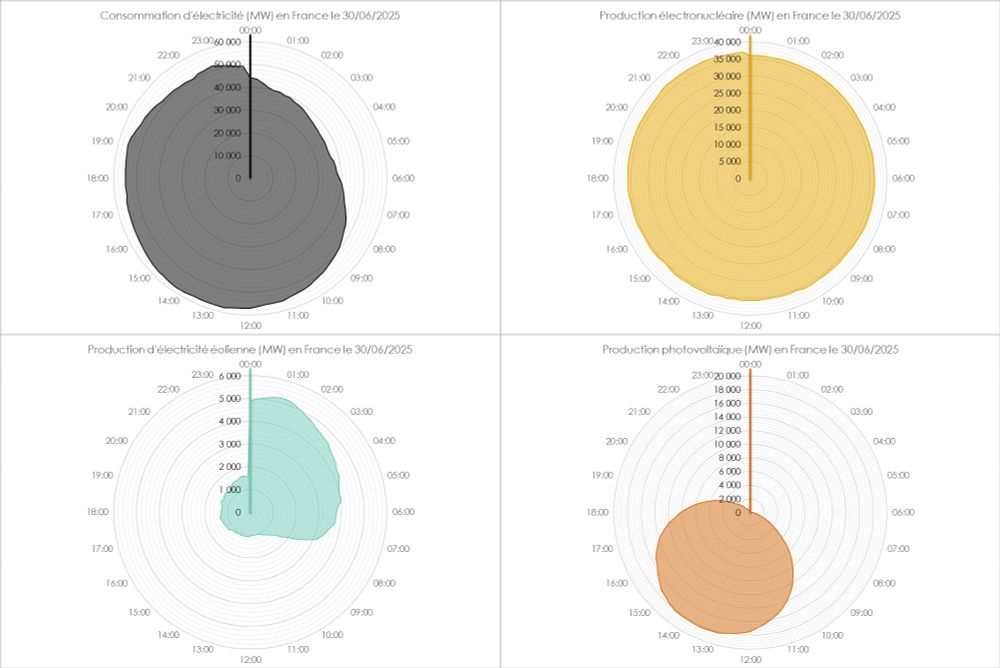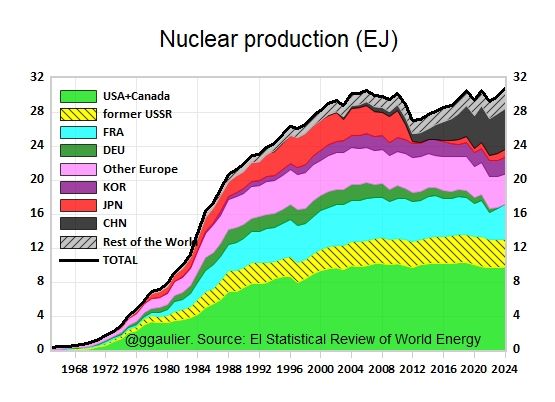Une décennie pour filmer le cosmos : la révolution Vera Rubin
Imaginez découvrir plus d’astéroïdes en quelques jours que l’humanité en 2 siècles. C’est exactement ce qui s’est passé entre la mi-avril et le début mai 2025, quand le télescope Vera Rubin a capturé ses premières images. Ces clichés révolutionnaires ouvrent la voie à des découvertes qui pourraient bouleverser notre compréhension du cosmos.
Perché à 2 673 mètres sur le Cerro Pachón au Chili, l’observatoire Vera Rubin est le fruit de plus de 20 ans de développement international. Rebaptisé en 2020 en hommage à la pionnière de la matière noire, ce télescope révolutionnaire dispose de la plus grande caméra jamais construite : 3,2 milliards de pixels capables de photographier 45 pleines lunes d’un seul coup.

Credit: RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA/T. Matsopoulos
Les images inaugurales récemment publiées sont spectaculaires. Les nébuleuses Trifide et de la Lagune révèlent des structures gazeuses d’un détail inouï, fruit de 678 prises de vue en 7 heures. L’amas de galaxies de la Vierge dévoile 10 millions d’objets célestes avec une précision jamais atteinte depuis le sol. En quelques heures seulement, Vera Rubin a identifié des milliers de nouveaux astéroïdes.
Crédit : Observatoire Vera C. Rubin (NSF–DOE)
Dès fin 2025, Vera Rubin entamera sa véritable mission : filmer l’Univers entier pendant 10 ans. La mission Legacy Survey of Space and Time va cartographier l’intégralité du ciel austral toutes les 3 nuits pendant cette période. Objectif : créer un véritable « film » de l’évolution cosmique, détecter millions d’astéroïdes, milliards de galaxies et milliers de supernovae. Ce projet promet de révolutionner notre compréhension de la matière noire et de l’énergie noire.
Le futur Extremely Large Telescope (ELT), avec ses 39 mètres de diamètre (première lumière en 2028), adoptera la stratégie inverse : résolution extrême sur de petites zones plutôt que cartographie massive. Tandis que Vera Rubin découvre, l’ELT scrutera. L’un balaye le ciel, l’autre plongera dans les détails avec 15 fois la résolution de Hubble.
Les limites de télescopes terrestres
Pourtant, ces télescopes se heurtent aux limites de leur localisation sur Terre. L’atmosphère bloque ou perturbe des pans entiers du spectre visible et invisible, les effets gravitationnels déforment les structures géantes, et les constellations du type Starlink « brûlent » jusqu’à 40 % des images avec leurs traînées lumineuses.
L’espace s’impose alors comme l’ultime frontière. James Webb l’a prouvé depuis 2022 : positionné à 1,5 million de kilomètres de la Terre, ce télescope spatial de 6,5 mètres de diamètre découvre des galaxies vieilles de 13,57 milliards d’années et analyse les atmosphères d’exoplanètes sans aucune perturbation atmosphérique.

Crédit : RubinObs/NSF/DOE/NOIRLab/SLAC/AURA/W. O’Mullane
Avec Starship bientôt capable de lancer 150 tonnes dans l’espace à coût dérisoire, l’heure des plus grandes ambitions a sonné. L’entrepreneur Casey Handmer propose de créer le « Monster Scope » : un télescope spatial auto-assemblé de 1km de diamètre. Ce colosse de 10 milliards de dollars – le prix de James Webb mais 22 000 fois plus sensible – examinerait les continents et rivières d’exoplanètes comme on observe la Lune.
Sommes-nous seuls dans l’univers ? Y a-t-il d’autres planètes habitables ? Des télescopes géants spatiaux pourraient nous permettre de répondre enfin à ces questions millénaires.
L’article Une décennie pour filmer le cosmos : la révolution Vera Rubin est apparu en premier sur Les Électrons Libres.