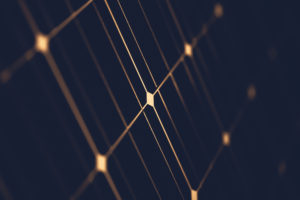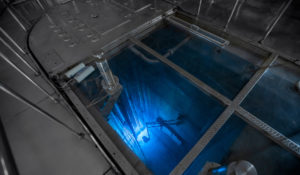Législatives : quel programme nucléaire pour les différents camps ?
Le 9 juin dernier, Emmanuel Macron a surpris les Français en annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale, entraînant des élections législatives anticipées prévues pour les 30 juin et 7 juillet. En tête des sondages se trouvent le Rassemblement national (RN) et le Nouveau Front populaire (NFP), qui ont tous deux placé l’énergie au cœur de leur campagne. Chacun propose des mesures destinées à réduire les coûts pour les ménages, dans un contexte où le pouvoir d’achat est une préoccupation majeure. Cependant, les propositions de chaque camp diffèrent nettement, reflétant leurs visions opposées sur le futur mix énergétique de la France. Les initiatives de la gauche rencontrent certaines difficultés, tandis que les promesses du parti d’extrême droite soulèvent des doutes quant à leur crédibilité, certaines semblant même être dénuées de fondement.
La continuité du programme pour le parti Renaissance
Le camp présidentiel préconise une approche de continuité, mais avec une expansion des réacteurs. Déjà engagé dans la commande de 6 nouveaux réacteurs EPR d’ici 2050, il envisage également la construction de 8 réacteurs supplémentaires par la suite. Ludovic Dupin, directeur de l’information de la société française d’énergie nucléaire, a souligné sur BFM TV l’engagement à long terme que cela représente, impliquant des décennies de formation et d’investissements.
Ces projets d’envergure montrent une volonté de renforcer la place du nucléaire dans l’avenir énergétique de la France, malgré leur complexité et leur coût élevé. Ce choix stratégique illustre une politique de renforcement des infrastructures énergétiques nationales pour les années à venir.
RN : un programme nucléaire irréaliste selon les experts
L’idée de transformer la France en un « paradis énergétique » dominé par le nucléaire et réduit en énergies renouvelables est au cœur du programme énergétique du Rassemblement national. Le projet du RN qui propose la mise en service de 20 réacteurs d’ici 2050, avec une mise en service de certains avant 2031, suscite l’inquiétude. Déjà évoqué lors de la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022, il semble toutefois relever plus du vœu pieux pour les experts. Leurs analyses prévoient un avenir énergétique marqué par des pénuries et une instabilité des prix de l’électricité.
Nicolas Goldberg, expert énergie chez « Colombus Consulting », interrogé par BFM TV critique cette ambition comme étant irréaliste : « Ce n’est pas possible en fait. Ils auraient pu dire 30 ou 40 tant qu’on y est. EDF annonce déjà que pour lancer les 6 ça va prendre du temps. Donc dire qu’il y aura des nouveaux EPR en service dès 2031, c’est faire porter au nucléaire une promesse intenable. »
Le Nouveau Front populaire : des divergences sur le nucléaire
Le débat sur l’énergie nucléaire continue de diviser profondément les partis de gauche en France. Ce désaccord s’est clairement manifesté lors de la récente présentation du programme commun par le « Nouveau Front populaire », où la question du nucléaire a été délibérément évitée pour maintenir une façade d’unité. Le nouveau Front Populaire laisse la question du nucléaire à débattre directement à l’Assemblée, sans prendre de position claire. Lors de la présentation du programme commun des gauches, Manuel Bompard de La France Insoumise a souligné que bien que le sujet du nucléaire reste sensible et clivant, il a été omis pour éviter d’exacerber les tensions internes.
Le « Nouveau Front populaire » promet une « loi énergie climat » pour planifier écologiquement l’avenir, mais esquive toute mention concrète du rôle du nucléaire, malgré son importance dans le mix énergétique actuel de la France. Cette absence de position claire pourrait conduire à des débats houleux à l’Assemblée nationale, où chaque parti défendra ses perspectives, potentiellement paralysant des initiatives énergétiques urgentes. Toutefois, la majorité s’accorde sur le fait qu’une réduction des capacités nucléaires actuelles serait préjudiciable pour les émissions de CO2 du pays.
L’article Législatives : quel programme nucléaire pour les différents camps ? est apparu en premier sur L'EnerGeek.