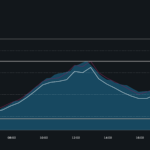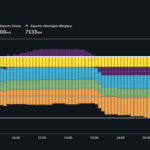Même pas terminée, cette usine de panneaux solaires sur trackers va fermer en Bretagne
Nouveau coup dur pour la filière française du photovoltaïque. En difficulté financière, le groupe OKWIND renonce à sa nouvelle usine avant même son inauguration, près de 90 emplois sont menacés.
L’histoire devait être belle. Le groupe breton OKWind, qui a construit son succès grâce à la fabrication de trackers solaires, devait continuer son expansion grâce à une toute nouvelle usine située près de Vitré, en Bretagne. Cependant, le groupe vient d’enregistrer un début d’exercice 2025 très inquiétant, obligeant la direction à prendre des mesures difficiles. Sur le premier semestre 2025, le groupe a enregistré une baisse de chiffre d’affaires de près de 57 % par rapport à l’année précédente, soit un recul de 13,4 millions d’euros. Et la situation ne s’est pas améliorée durant le second semestre puisque sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires a été de 18,4 millions d’euros contre 46 millions d’euros jusqu’en septembre 2024.
OKWind va désormais mettre en place un grand plan de transformation pour tenter de survivre. Ce plan passe par la revente d’une usine à peine construite qui n’est plus adaptée à l’activité de l’entreprise. Surtout, ce sont près de 89 postes qui sont menacés, soit 40 % des effectifs de l’entreprise.
À lire aussi Cette usine française de panneaux solaires est jetée à la poubelle après sa failliteLes trackers solaires, de plus en plus difficiles à justifier ?
Fondé en 2009, le groupe OKWIND s’est développé rapidement en déployant une énergie solaire locale et bas carbone, grâce à des trackers solaires dont le premier modèle a été installé en 2015. Si les trackers solaires sont fréquents sur les sites agricoles et les sites industriels, OKWIND a pris le pari de développer un modèle dédié aux particuliers, à travers sa filiale Lumioo en 2020. Il faut reconnaître que les trackers solaires ont des atouts indéniables en permettant une optimisation constante de l’énergie du soleil. Avec ce type d’installation, le pic de production est étalé sur plusieurs heures, ce qui permet de mieux profiter de l’énergie solaire. De plus, ces installations peuvent représenter un véritable gain de place quand une installation en toiture n’est pas possible.
Néanmoins se pose la question du prix et du retour sur investissement depuis la baisse considérable du prix des panneaux solaires. Dans le cas des trackers solaires, le prix des panneaux devient marginal en comparaison au coût de la structure et du dispositif de suivi. C’est particulièrement flagrant pour les particuliers. Lumioo commercialise son tracker solaire destiné aux particuliers à un tarif supérieur à 11 000 € pour une puissance de 1480 Wc.
À titre de comparaison, le prix d’une installation traditionnelle en toiture débute aux alentours de 6 000 € ou 7 000 € pour une puissance de 3 000 Wc. Dans ces conditions, la différence d’investissement est difficile à justifier. Le groupe a annoncé vouloir recentrer son portefeuille d’activités sur les offres les plus attractives, à plus fortes valeurs ajoutées, notamment via les technologies favorisant l’autonomie énergétique pour laquelle les trackers sont particulièrement adaptés.
L’article Même pas terminée, cette usine de panneaux solaires sur trackers va fermer en Bretagne est apparu en premier sur Révolution Énergétique.