Y aura-t-il des ads ibou ?
![[Offert] Ibou : comment le moteur de recherche « made in France » veut indexer le web](https://next.ink/wp-content/uploads/2025/09/portrait_Peyronnet.webp)
Est-il possible de créer aujourd’hui un moteur de recherche sans faire partie des plus grosses entreprises du secteur ? Pour explorer ce thème, nous nous sommes entretenus avec Sylvain Peyronnet, PDG de Babbar.
Pour les fêtes de fin d’année, Next vous offre cet article initialement paru le 24 septembre 2025 et réservé aux abonnés. Pour lire les prochains entretiens dès leur publication, abonnez-vous !
Depuis quelques semaines, Next a repéré sur les réseaux sociaux un nouveau projet français de moteur de recherche (conversationnel, cette fois) porté par l’entreprise Babbar : Ibou. Connaissant un autre projet de moteur de recherche dont les résultats se sont trouvés datés et limités, nous étions curieux de savoir s’il était possible d’en monter un avec un index correct, à jour et qui pourrait profiter des nouvelles technologies comme les LLM pour améliorer son fonctionnement.
Nous avons interrogé Sylvain Peyronnet, PDG de Babbar. Son entreprise est spécialisée dans les outils permettant aux spécialistes du SEO d’améliorer leurs stratégies. Lui est un ancien enseignant-chercheur en intelligence artificielle, mais aussi l’ancien responsable scientifique de Qwant, parti en 2019.
>> Qu’est-ce qu’il y a derrière ce nom d’Ibou à l’apparence très française ?
C’est un projet de moteur de recherche de l’entreprise Babbar. Celle-ci fait, depuis que j’ai quitté Qwant et qu’on l’a montée, des outils qui font tourner en arrière-plan un moteur recherche, pour comprendre ce que fait Google et fournir de la data aux gens qui font du référencement web. Pour différentes raisons, nous avons décidé de pivoter. Nous avons commencé à créer un moteur de recherche conversationnel depuis quelques mois. Et nous l’avons annoncé quasiment dès qu’on a commencé le travail.
Ibou, même si on joue beaucoup avec des logos liés à l’oiseau parce qu’on est en France, ça n’a rien à voir : c’est un mot d’égyptien ancien qui veut dire « les cœurs », car, dans l’Égypte ancienne, le cœur était le siège du raisonnement et de la mémoire.
>> Qu’est-ce qui vous a amenés à imaginer ce projet ?
En travaillant dans le secteur du moteur de recherche depuis longtemps, nous nous sommes rendu compte de plusieurs choses.
Déjà, jusqu’au paradigme conversationnel, les moteurs n’étaient pas vraiment faits pour de la recherche d’information, mais pour de la recherche documentaire : ils renvoyaient des pages web. Pourtant, quand les gens tapent une requête dans un moteur, la plupart du temps, ils s’en fichent un peu. Ce qu’ils attendent, c’est une réponse qui les satisfait et qui leur permet de réaliser les tâches qu’ils veulent réaliser.
« L’émergence des LLM a permis de faire percoler des informations humaines dans des objets mathématiques »
Ensuite, pour faire un bon moteur, le nerf de la guerre était d’avoir beaucoup de données utilisateurs pour comprendre l’être humain et affiner ce que faisaient les algorithmes et qui n’était jamais parfait. Et pour parfaire les résultats d’un moteur, il fallait beaucoup de comportements humains.
L’émergence des LLM, et surtout des LLM alignés, a permis de faire percoler des informations humaines dans des objets mathématiques, les modèles. Maintenant, une partie des choses qui pouvaient être faites grâce à la data humaine peut être faite grâce aux modèles qui existent. Bien sûr, ceux-ci ont été fabriqués avec de la data humaine. Mais, comme c’est à l’intérieur du modèle et que c’est pas très cher de faire tourner des modèles, une partie de la difficulté, et notamment de la barrière à l’entrée, de la création d’un moteur a disparu, parce que le modèle a incorporé cette connaissance des humains.
C’est pour ça qu’on a décidé de se lancer aujourd’hui. En réalité, n’importe quelle équipe de personnes qui sont un peu douées en algorithmique peut faire des moteurs de bonne manière.
>> L’idée est donc de faire un moteur de recherche conversationnel sur quels types de contenus ? Textuels, images, audio ?
Notre moteur a vocation, à terme, à mettre en avant l’information. Et donc la multimodalité fait partie du pack, puisqu’en réalité, l’information n’est pas que textuelle, qu’image, etc. Mais il faut être raisonnable : au début, on ne va avoir que textes et images. Pour la vidéo, ce n’est pas un problème algorithmique, mais nous n’avons juste pas les moyens. Ça arrivera plus tard si on arrive à montrer qu’on est capables d’avoir des résultats de bonne qualité sur textes et images.
Mais nous avons une vision un peu différente des autres de ce que doit être un moteur de recherche, et une vision plus ouverte du web que ce que proposent la plupart des plateformes actuelles. Notamment, nous voulons être un moteur qui répond à l’utilisateur, mais pas comme un LLM classique comme ChatGPT ou autres, avec un texte qui explicite absolument tout. Cela génère souvent une mauvaise qualité de réponse.
« On veut aussi garantir un pluralisme »
Indépendamment des hallucinations ou des mensonges, en réalité, les gens veulent souvent accéder à une source. La bonne réponse, de notre point de vue, est l’explication de pourquoi il faut aller lire une source. Nous voulons nous interposer à un niveau intermédiaire avec toutes les modalités qui permettent d’expliquer, les images, les cartes, etc.
On pense aussi qu’il ne faut pas prendre les gens pour des abrutis. Actuellement, les moteurs ont des biais terribles et ne présentent qu’une seule partie de l’information. On veut aussi garantir un pluralisme. L’actualité est traitée par chaque média depuis son point de vue, et c’est compréhensible, chaque média a sa ligne éditoriale particulière. Mais un moteur de recherche peut tout à fait mettre en avant la diversité de point de vue.
>> Ça fait penser aux vieilles approches de portail d’informations comme Yahoo ou autre. Vous en êtes-vous inspirés ?
Peut-être de façon involontaire : ça correspond à l’image du web qu’on a dans l’équipe, qui est plus composée de vieux barbus que de startupers. Mais la technologie permet de faire des choses beaucoup plus subtiles que ce qu’on faisait avant. Nous allons avoir une verticale qui va se rapprocher fortement d’un portail : Ibou Explorer, un équivalent de Google Discover, mais de qualité. Ici, toutes les sources seront directement présentées dans leur diversité, avec une personnalisation. On sera là plus proche d’une idée de portail, comme ceux de Yahoo, etc. J’espère qu’on va réussir à faire un meilleur travail.
Par contre, sur la partie moteur, il y a une partie de curation. Il va falloir trouver le bon équilibre et savoir où la curation s’arrête : on ne veut pas prendre le pas sur la réflexion de l’humain.
>> Concernant la curation, il y a aussi celle des contenus diffusant des informations volontairement fausses et des contenus générés par IA. Ibou va-t-il prendre en compte ces problématiques ?
Ce sont deux sujets sur lesquels nous travaillons. Le premier, la véracité de l’information, est le plus simple. Nous expliquons dans notre manifeste que nous voulons donner des informations de qualité. La qualité, pour nous, étant la correction de l’information et son utilité. Pour l’utilité, c’est assez clair : à tel type de personne, est-ce que l’information va lui servir pour réaliser sa tâche ?
La correction est de savoir si une chose est vraie ou fausse, sachant qu’il y a toute une gradation et qu’à un moment donné, une chose peut n’être ni vraie ni fausse (une opinion, par exemple). Il y a une vraie difficulté technique à faire ça. Nous avons prévu un processus pour qu’une chose abusivement fausse ne puisse pas passer, avec quelques erreurs de temps en temps. Mais sur l’actualité, il est parfois difficile de repérer le mensonge. La grosse partie de ce qui est de la propagande, qui est de la manipulation, se repère plus sur la qualité intrinsèque des contenus que par rapport à l’information elle-même et sa véracité.
Par rapport aux contenus IA, dans notre prototype Ibou Explorer, ce qui compte, ce n’est pas que le contenu soit généré par IA ou pas, mais s’il a un niveau tel qu’il aurait pu être écrit par un être humain. Nous allons donc plutôt qualifier si un contenu qui s’annonce journalistique s’appuie réellement sur les sources qu’un journaliste aurait utilisées, par exemple. On essaye de vérifier quel est le type de personne qui a écrit (en s’appuyant sur le niveau de langage, le type d’écriture, si la personne a écrit des articles dans des médias de confiance, etc). C’est des choses qu’on arrive à faire et qu’on peut utiliser.
Pour Ibou Explorer, c’est d’autant plus facile à faire qu’on est sur un nombre de sites qui est beaucoup plus petit. Il est donc beaucoup plus facile de comprendre quelles sont les sources de qualité et les autres. Sur le search à très grande échelle, il faut que nous industrialisions ce processus, ce qui coûte très très cher. Nous essayons en ce moment d’en réduire les coûts.
>> Mais il est difficile, pour le public, de comprendre quels paramètres permettront de discriminer…
C’est la vraie problématique. Nous voulons être transparents algorithmiquement. Nous allons donc communiquer certaines choses. Nous faisons des analyses sur le vocabulaire utilisé, on le compare au vocabulaire utilisé sur d’autres sites web, etc. Par exemple, pour le Monde, nous listons les contenus qu’il publie et statistiquement leurs caractéristiques. Ça crée ensuite des empreintes pour des classifieurs qui permettent de facilement repérer si des contenus sont susceptibles d’être les mêmes, s’en approchent, etc. C’est par des artifices statistiques que nous allons faire les choses, c’est le seul moyen d’automatiser.
Bien sûr, nous savons qu’il y a toujours moyen, en travaillant vraiment à publier des choses qui ressemblent à de bons articles. L’avantage, c’est que les gens qui font de la fake news publient en masse et ne travaillent pas bien un article unitairement, et il est donc possible de les repérer.
Les jugements humains d’invalidation, notamment pour la partie Ibou Explorer, ne viendront qu’a posteriori.
Mais il y a des mécanismes algorithmiques en plus sur lesquels nous ne pouvons pas être transparents, sinon les gens pourraient savoir comment passer outre. Par contre, nous allons mettre en place une interface, un peu comme la Google Search Console, où les gens pourront demander pourquoi telle ou telle page n’est pas dans Ibou. Et nous donnerons la qualification que nous en faisons (« il n’est pas de qualité pour telle ou telle raison », par exemple), sans pour autant expliquer comment nous l’avons fait.
Nous avons un système, par exemple, qui donne la probabilité qu’un contenu soit écrit par un humain, une IA ou un humain assisté d’une IA. Bien sûr, ça se trompe : il y a souvent des contenus écrits par des humains qui sont détectés comme générés par des IA parce que les humains ont mal écrit. On se trompe davantage dans ce sens, car il y a assez peu de gens qui font de bons contenus IA. Nous donnerons aussi un outil qui analysera le texte et qui donnera notre conclusion.
>> Ciblez-vous l’indexation du web francophone, anglophone ou carrément tout le web ?
Aujourd’hui, nous crawlons tout le web, même si nous avons priorisé le francophone et quelques langues des pays limitrophes à la France. Nous ferons ensuite toutes les langues qu’on peut faire : pour des raisons algorithmiques, certaines langues (indépendamment des marchés) sont difficiles, comme les langues asiatiques ou le finlandais. Le russe, nous ne l’indexons pas. Même dans Babbar, nous ne le crawlons plus, en ce moment : ça ne sert à rien puisqu’il n’y a plus de marché.
Nous n’avons pas vocation à nous limiter à notre marché domestique. Mais on va mettre une priorité sur les contenus européens, car notre public sera probablement européen, mais ça ne veut pas dire qu’on ne traitera pas les autres langues. On va simplement favoriser des contenus susceptibles d’être cherchés par nos utilisateurs.
>> Concernant la souveraineté, quelle est votre position ? Où seront installés vos serveurs ?
Je n’aime pas cet axe de la souveraineté qui est utilisé par beaucoup de mes camarades. Nous sommes plus souverains que quiconque. Nous avons des machines qui nous appartiennent en propre, physiquement. Nous les maintenons avec nos équipes en France et elles sont à Marcoussis dans le 91.
Nous n’utilisons pas de solution de cloud : nos modèles tourneront « on premise », ne serait-ce que pour des raisons économiques et écologiques. Ça n’a aucun sens d’utiliser du cloud, surtout aux États-Unis, pour faire ça. Nos données sont stockées en France. Enfin, pour garantir notre service, nous avons des machines que nous administrons chez deux opérateurs : OVH (en France et aux Pays-Bas) et Scaleway (en France). Nos capitaux sont tous français. Mais je dis plutôt « made in France » plutôt que « souverain ». Pour nous, ça coule de source, puisqu’on vit et on travaille ici.
>> Quelles ressources en temps et en argent sont nécessaires pour crawler le web maintenant et le sauvegarder ?
Beaucoup moins qu’avant. Moins pour nous que pour d’autres, mais ça demande quand même beaucoup de ressources. Crawler le web, ce n’est pas ce qui va demander le plus de ressources, mais c’est le stocker et l’indexer ensuite. Aujourd’hui, le crawler historique à l’origine de la technologie mise en place pour Babbar tourne sur six à huit serveurs et doit nous coûter pas plus de 15 000 euros par mois pour crawler quatre milliards de pages par jour.
Ce qui coûte très cher, c’est le stockage. Mais avec une infrastructure qui coûte à la louche un million d’euros, on a une infrastructure qui se situe dans les 15 premiers crawlers mondiaux et qui est largement capable de scrawler un index qui peut servir toute l’Europe. On a créé une énorme base de données.
Mais un moteur de recherche, c’est aussi des millions d’utilisateurs et les infrastructures de services coutent cher aussi. Il faut donc faire « scaler » le service, ce qui est uniquement proportionnel au nombre d’utilisateurs.
Tout ça, ce sont quelques millions d’euros maintenant, là où c’étaient des dizaines de millions il y a quelques années.
>> Quelle est modèle économique du projet Ibou ?
C’est le même que tout le monde. Il ne sera pas mis en avant dans un premier temps, mais ce sera un modèle lié à de la monétisation. C’est un modèle B2C, avec monétisation B2C standard et un peu de publicité, un peu d’affiliation, des fiches entreprises… Le nerf de la guerre, pour financer les opérations, ce sera essentiellement d’avoir du trafic. Comme Google, Bing, etc. Pour l’affiliation, la logique ne sera pas d’avoir un deal exclusif avec un programme d’affiliation en particulier, mais de faire des deals avec plusieurs programmes.
« Quelqu’un qui fait 20 ou 30 millions d’euros par an en France peut faire un moteur de recherche très rentable »
Nous débutons et on sait que ça coute cher d’entretenir un moteur, il faut quelques millions par an, mais ça ne coute pas le prix auquel voudraient nous faire croire les GAFAM. Il n’y a pas besoin de faire 10 milliards de bénéfices pour faire tourner un moteur de recherche. Quelqu’un qui fait 20 ou 30 millions d’euros par an en France peut faire un moteur de recherche très rentable.
>> Est-ce que vous assurerez à vos utilisateurs que leurs données seront protégées ?
Ayant travaillé chez Qwant, je ne sais pas qui est capable de donner une telle garantie. Je pense que c’est littéralement impossible. La donnée utilisateur que nous allons garder qui pourra intéresser le plus le RGPD, ce sera la donnée de personnalisation du Ibou Explorer, à travers un compte utilisateur et le consentement pour l’utiliser.
Mais elle ne sera pas utilisée par les algorithmes de pub, car ceux-ci n’en ont finalement pas besoin. Ils ont besoin juste de savoir ce sur quoi ils s’affichent. Et quand une page s’affiche, maintenant avec les LLM, c’est extrêmement simple de comprendre le contexte de la page. Avec des éléments de contexte suffisant, on peut faire de la pub qui est aussi performante que celle qui utilise l’information utilisateur. Donc pour la pub que nous opérerons nous-mêmes, il n’y aura pas de données utilisateur conservées et utilisées. Après quand on envoie quelqu’un chez un tiers, on ignore ce qui s’y passe.
>> Donc pas de système de traqueurs dans le modèle économique de Ibou ?
Non. Déjà, ce n’est pas notre vision. Et je pense que si on fait ça, on devient un aspirateur de données et on ne fait plus le même moteur. Si on devait faire ça, actuellement, on ferait plus un réseau social.
>> Le copyright et les droits voisins sont des questions sensibles quand on parle de moteur de recherche avec IA générative. Comment envisagez-vous la question ?
Nous envisageons la question verticale par verticale. Sur la partie Ibou Explorer, qui est la plus touchy (80 % des contenus viennent de médias), nous n’allons pas faire de résumé IA. Nous ne voulons pas nous approprier les contenus. Nous ne faisons que du renvoi de trafic vers les tiers, avec un mécanisme d’opt-out et des accords partenariaux.
Sur la partie search, il y aura aussi un mécanisme d’opt-out, car il y a des problématiques qu’on ne pourra jamais résoudre. Pour la partie présentation de l’information, nous voulons systématiquement renvoyer vers les sources. Par exemple, si quelqu’un demande « est-ce qu’il faut un visa pour aller dans tel pays ? », notre système va répondre « oui » ou « non », mais ne va pas donner plus d’informations. Il va, par exemple, répondre « Oui et tout est expliqué sur ce site » et c’est seulement si la personne demande d’aller plus loin sans passer par le site qu’on va donner plus d’informations. Nous voulons renvoyer au maximum vers les sources elles-mêmes.
Nous réfléchissons encore à un mécanisme pour reverser une partie des revenus associés aux réponses qui contiennent cette source, mais nous n’avons aucune idée encore de ce qu’on voudrait faire.
« La connaissance, c’est du ressort du moteur de recherche et des sources, pas du LLM »
>> Concernant la possibilité de régurgitation de contenus copyrightés, comment gérerez-vous ?
C’est un problème qui n’existera pas. Venant de l’IA, nous faisons partie des gens qui pensent que les LLM ne sont absolument pas autre chose qu’un outil d’écriture. Nous n’utiliserons pas d’information contenue dans le LLM. Ça change d’ailleurs tout pour nous, parce que nous n’avons pas besoin d’utiliser un LLM de très grande dimension comme ceux d’OpenAI ou à 500 milliards de paramètres. Ça n’a aucun intérêt de s’en servir, car s’ils ont autant de paramètres, c’est pour pouvoir s’en servir sur des questions qui nécessitent de la connaissance. C’est une profonde erreur.
La connaissance, c’est du ressort du moteur de recherche et des sources, pas du LLM. De tous les mastodontes qui existent devant nous, le seul qui est sur une approche à peu près similaire à la nôtre, c’est Perplexity. Mais ChatGPT et les autres font une profonde erreur : ils ne pourront jamais faire des bons outils de recherche, car ils sont persuadés que le LLM peut contenir du savoir et de l’information, ce qui n’est pas vrai. Ils n’ont pas été créés pour ça et on croit qu’ils en contiennent, car ils sont capables de broder un discours sur des bribes d’information qu’ils ont vues. Ce qui n’est pas du tout la même chose que d’avoir de l’information.
Tant qu’on ne va pas au-delà des transformers, la question est réglée par le fait qu’en réalité on a un moteur de recherche avec un index proche de ce qui se faisait avant, mais qui peut être facilement interfacé avec un LLM, qui lui va se contenter d’écrire les réponses. Chacun son rôle : le LLM comprend la langue, le moteur connaît l’information. Le LLM est un documentaliste qui sait utiliser un moteur de recherche et qui peut nous renvoyer vers les contenus pertinents.
C’est aussi le seul moyen de contrôler la véracité d’une information. Sinon, quand on fait confiance à un LLM pour donner une information, il y a toujours 5 à 10 % de taux d’erreur automatiquement.
>> Pourra-t-on utiliser les opérateurs de recherche comme site:, intitle: ou fileformat: ?
Le moteur grand public d’Ibou ne le permettra pas car c’est un moteur conversationnel et que nous n’indexons pas à proprement parler les pages web, mais les informations les plus importantes et une référence à la page. Ainsi, toute une partie des opérateurs devient inopérante, car on peut indexer le titre parce qu’on pense que c’est du contenu important sans pour autant stocker que c’est le titre.
Il y a aussi une API sur l’index qui existe et qu’on utilise pour faire le moteur. Ce n’est pas exclu qu’on permette à d’autres de pouvoir y accéder.
>> Pourquoi, maintenant, pensez-vous que c’est possible d’indexer le web alors que Qwant, pour lequel vous avez travaillé, a essuyé des problèmes pour le faire à l’époque ?
Dans Babbar, on indexe et on crawle déjà beaucoup plus que ce qui est nécessaire pour faire un moteur de recherche, car on vend de la data aux référenceurs. On doit vendre aussi de la data que les moteurs ne prennent pas en compte pour aider les SEO à comprendre pourquoi ils arrivent à se positionner et pourquoi ils n’y arrivent pas.
« Faire un index qui classe les bonnes pages dans les premières, c’est ça qui est difficile »
À Babbar, on a un index qui était de 2 000 milliards de pages, mais qui a beaucoup diminué pour lancer Ibou : on est maintenant à 1 400 milliards de pages sur la partie Babbar. Et même si ce n’est pas tout à fait les mêmes index puisqu’un moteur a besoin de plus de données mais sur moins de pages, on est sur des choses très similaires. Et faire un index, ce n’est pas un problème : on a déjà un index complet qui tourne avec des résultats de recherche. Mais même si on pense qu’on est déjà meilleurs que d’autres ne l’ont été précédemment, pour l’instant, on estime que notre projet n’est pas encore au niveau et on ne veut pas créer une mauvaise image alors qu’on est encore en train de travailler.
La seule vraie difficulté qu’il y avait avant, ce n’était pas la partie index – que nous avons résolue dans Babbar depuis longtemps –, mais qu’il fallait de la data utilisateur pour faire les choses. Faire un index qui contient les bonnes pages, ce n’est pas difficile, faire un index qui classe les bonnes pages dans les premières, c’est ça qui est difficile. Ce sont les fonctions de ranking.
Depuis 2005, ces fonctions n’étaient bonnes que s’il y avait une data utilisateur qui permettait de compenser tous les problèmes que les algorithmes ne sont pas capables d’arbitrer. C’est ce qu’on a vu dans le procès de Google : l’utilisation massive de la data comportementale des utilisateurs au niveau du moteur, c’est ça qui fait la qualité du moteur. Et Google est le plus fort, parce qu’il a beaucoup plus de données que Bing par exemple. Mais avec les LLM, il n’y a plus besoin de cette data pour faire quelque chose de bien, parce que le LLM peut simuler l’humain en grande partie et suffisamment bien pour faire les dernières étapes de tris.
Une fois que les algorithmes ont bien travaillé, il reste des scories : peut-être 10, 20 ou 30 % de l’index sont en tête et ne devraient pas, et c’est le LLM qui en enlève une grosse partie. Et en plus, quand on fait la synthèse des réponses, le LLM prenant plusieurs sources simultanément réussit à donner une réponse qui est bien meilleure que si on prenait chaque source indépendamment les unes des autres, en faisant comme l’être humain qui va lire plusieurs contenus pour faire sa propre opinion.
Pour en revenir à la question, cette dernière étape, qui était plus une étape de coût, est beaucoup plus facile à faire et la barrière de la data massive a complètement disparu.
>> Quelle est l’articulation entre Babbar et Ibou ?
C’est la même boite, les mêmes personnes. Nous espérons que tout va bien se passer pour nous, avec peut-être de l’aide de l’extérieur on ne sait pas encore, et qu’on va pouvoir recruter cette année. Par contre, ce sont des infrastructures techniques séparées parce que ce sont des outils qui n’ont pas du tout le même objectif. Donc algorithmiquement, c’est assez différent pour qu’il n’y ait aucun intérêt pour nous à ce que ce soient les mêmes plateformes.
Le crawler de Babbar est un crawler SEO, le crawler d’Ibou sera un moteur de recherche. Nous n’avons pas vocation à être autorisés à crawler de la même manière tous les sites selon le métier. Si on avait un crawler IA, ce serait encore une autre plateforme, car on ne peut pas mélanger les genres et que, pour être respectueux des gens, c’est ce qu’il faut faire. On veut aussi séparer parce que, aujourd’hui, notre activité est largement soutenue par notre activité SEO, mais on se doute qu’à un moment donné se posera la question de savoir si les deux activités doivent rester côte à côte ou pas.
>> Quand Ibou sera disponible ?
Pas avant un an. Pour les premières verticales, comme la partie Ibou Explorer (ndlr : l’équivalent de Google Discover), ça devrait arriver début 2026.


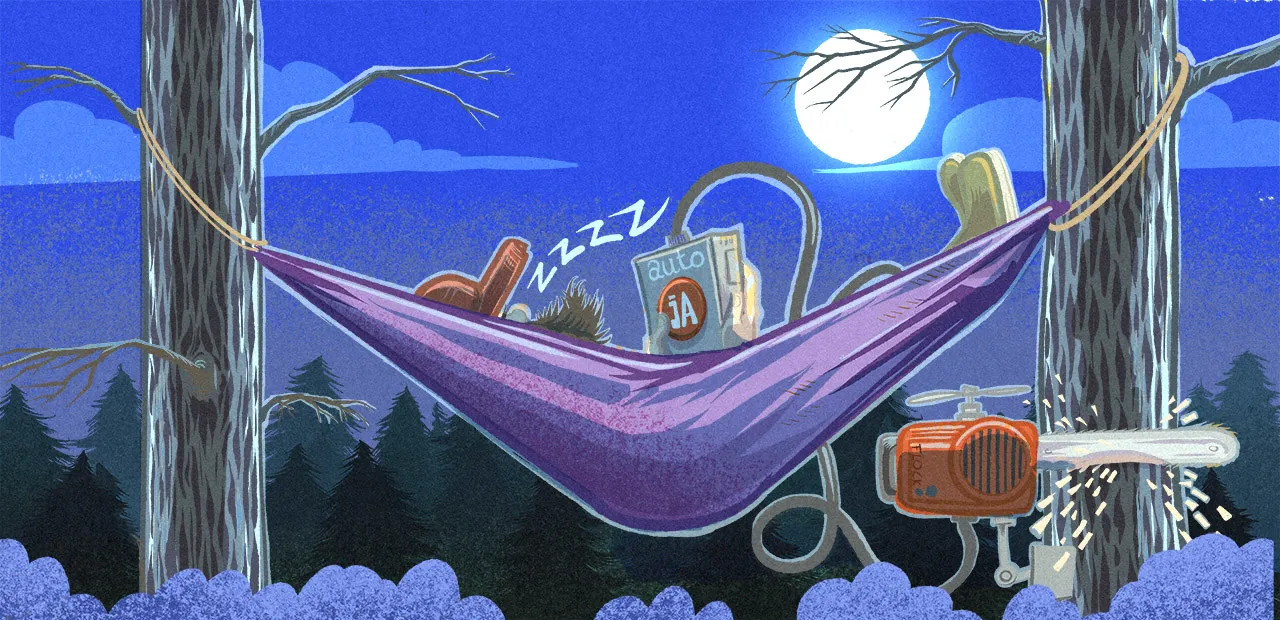
















![[MàJ] Cyberattaque : les services de La Poste toujours indisponibles](https://next.ink/wp-content/uploads/2024/02/Securite4.webp)



![[Offert] Ibou : comment le moteur de recherche « made in France » veut indexer le web](https://next.ink/wp-content/uploads/2025/09/portrait_Peyronnet.webp)








