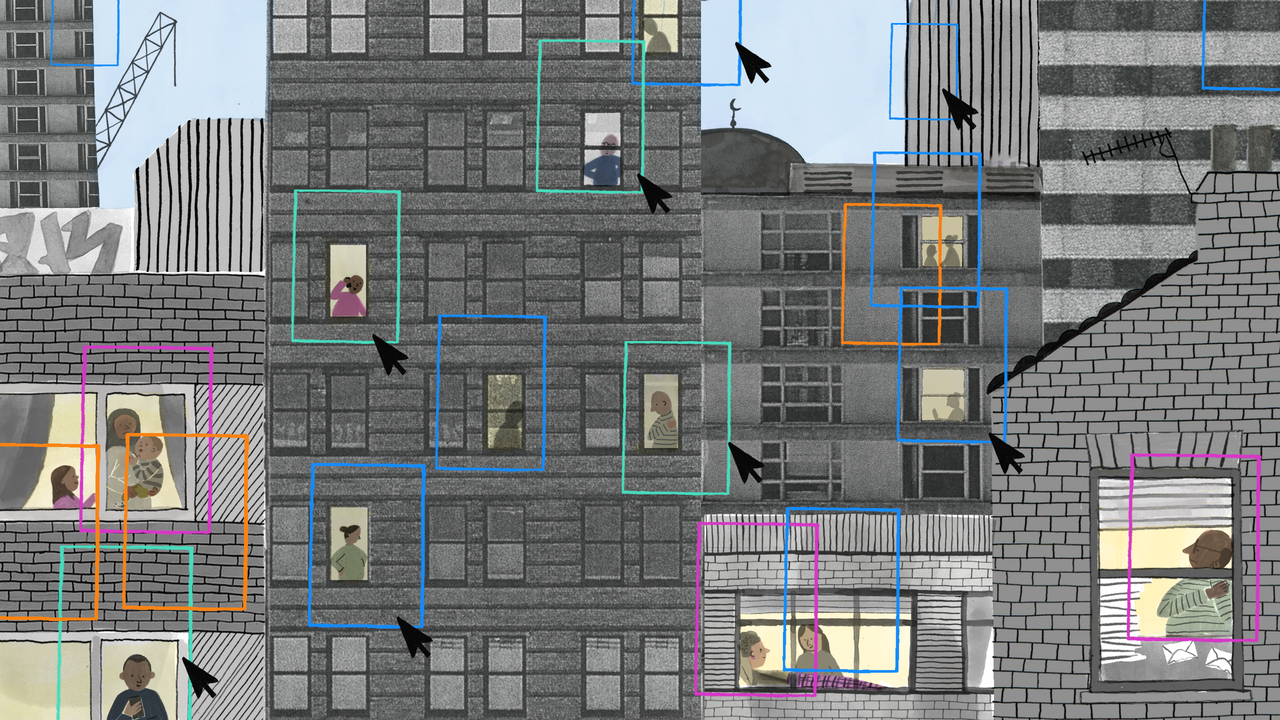Jolla revient avec un nouveau smartphone sous Sailfish OS, le Do It Together
Joli Jolla

Jolla est de retour avec un nouveau smartphone, le Do It Together. Présenté comme une alternative européenne, le smartphone fait l’objet d’une campagne participative, dont les deux premiers jalons sont déjà atteints.
Sailfish OS est née des cendres du projet MeeGo, un système d’exploitation développé conjointement par Nokia et Intel. En 2011, Stephen Elop, responsable chez Microsoft, devient président de Nokia, il est décidé que l’avenir de l’entreprise passera entièrement par la plateforme Windows Phone. On connaît la suite : malgré des modèles globalement réussis et disposant de qualités certaines, les modèles Windows Phone ne rencontreront qu’un succès limité. La faute principalement au manque d’applications sur la boutique.
De fait, l’entreprise finlandaise Jolla, qui développe le système, a été fondée par un groupe d’anciens employés de Nokia, partis quand Stephen Elop est arrivé. Quelques modèles sont sortis directement avec la marque Jolla, mais Sailfish OS s’est surtout fait connaître comme alternative à Android, bien qu’avec une liste réduite d’appareils compatibles, comme le Xperia 10 II de Sony.
Avec le temps, Jolla s’est tourné vers d’autres domaines pour son système (basé sur Linux), notamment l’industrie automobile. L’entreprise est devenue rentable en 2021, presque dix ans après sa fondation, comme l’indiquait alors TechCrunch.
L’entreprise est de retour avec un tout nouveau modèle. Baptisé Do It Together (en opposition au Do It Yourself), le nouveau smartphone est présenté comme une alternative européenne aux grands noms de la tech, pratiquement tous américains. Fourni avec Sailfish OS 5, dernière révision stable du système, il se veut entièrement tourné vers la confidentialité et le respect de la vie privée.


Un bouton configurable pour la vie privée
La base technique du nouveau téléphone est centrée sur une puce Mediatek « hautes performances » dont la référence est inconnue. Le téléphone est compatible 5G, embarque 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage (extensibles jusqu’à 2 To via microSDXC) et présente un écran AMOLED 1080p de 6,36 pouces (environ 390 ppi, ratio de 20:9), recouvert d’une couche Gorilla Glass. La partie photo comprend deux capteurs, un grand angle de 50 MP et un ultra grand angle de 13 MP. Une caméra frontale grand angle est également présente, mais on n’en sait pas plus.
Le smartphone présente des dimensions de 158 × 74 × 9 mm, mais son poids n’est pas précisé. Il est disponible en trois couleurs : Snow White, Kaamos Black et The Orange. C’est cette dernière que la communication met surtout en valeur. On trouve aussi un lecteur d’empreintes latéral, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.4.
L’annonce ne donne pas tous les détails techniques. Dans la FAQ, on peut d’ailleurs lire que le reste des informations sera donné durant le premier trimestre 2026. En revanche, on sait déjà que le Jolla DIT se distinguera par deux caractéristiques. D’une part, la batterie (de 5 500 mAh) sera remplaçable rapidement par retrait de la coque arrière (d’ailleurs personnalisable). D’autre part, l’appareil présente sur la tranche un Privacy Switch. Ce bouton permet de couper physiquement le Bluetooth, le micro ou encore les applications Android. Son comportement peut être modifié afin d’ajouter ou retirer des éléments.
Jolla indique dans la page du projet que le DIT est une émanation de la communauté : les principales décisions prises sur les caractéristiques ont fait l’objet d’un vote. Précisons également que Sailfish OS intègre MicroG pour permettre le fonctionnement des applications Android, qui peuvent être installées notamment via la boutique F-Droid.
Succès quasi immédiat du financement participatif
Jolla n’a pas mis directement en vente son modèle. L’entreprise voulait s’assurer en effet que la demande serait au rendez-vous. Elle a donc proposé un financement participatif le 5 décembre, avec un objectif initial de 2 000 précommandes au prix de 499 euros. Ce jalon a été atteint en moins de 48 heures. Jolla a donc décidé d’ajouter un deuxième lot de 2 000 précommandes, cette fois à 549 euros. L’objectif a également été atteint.
Actuellement, le nombre de précommandes dépasse les 5 200, le nouveau palier étant de 10 000 unités. Jolla précise d’ailleurs que ce nouveau plafond ne sera pas repoussé, même si l’objectif est rempli. Les personnes intéressées ont encore 20 jours pour précommander le DIT, via un paiement de 99 euros. Dans la FAQ, il est précisé que cette précommande peut être annulée et que la somme sera rendue.
Ce n’est pas la première fois que Jolla recourt au financement participatif. L’entreprise s’en était par exemple servi dès 2014 pour sa tablette.