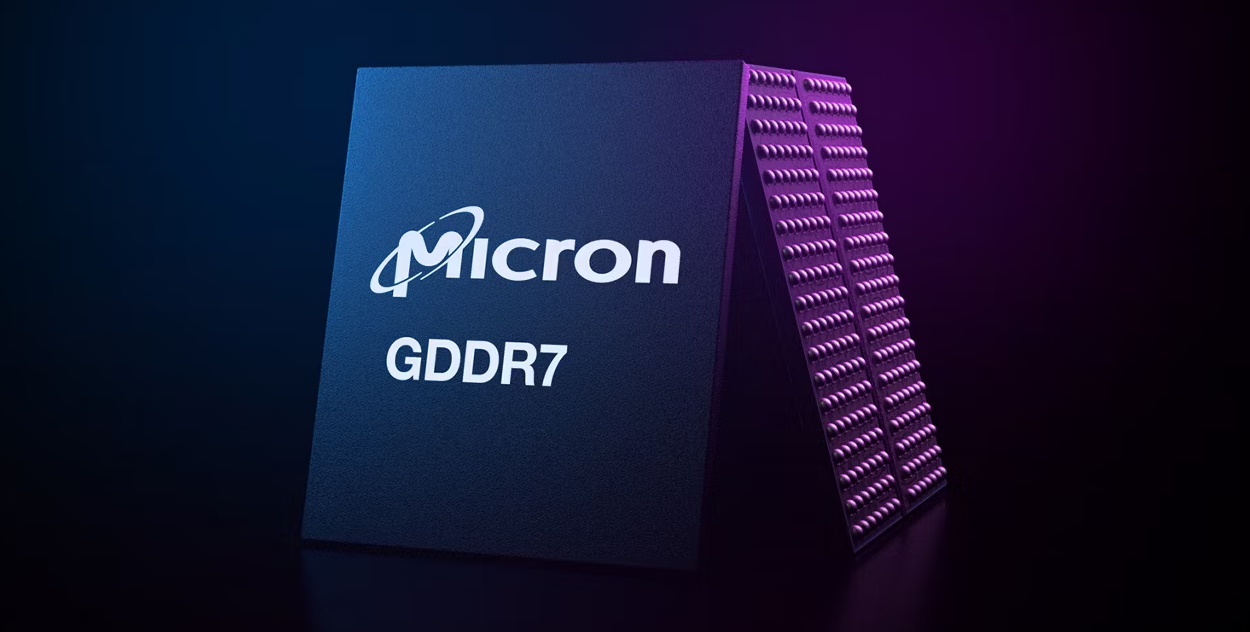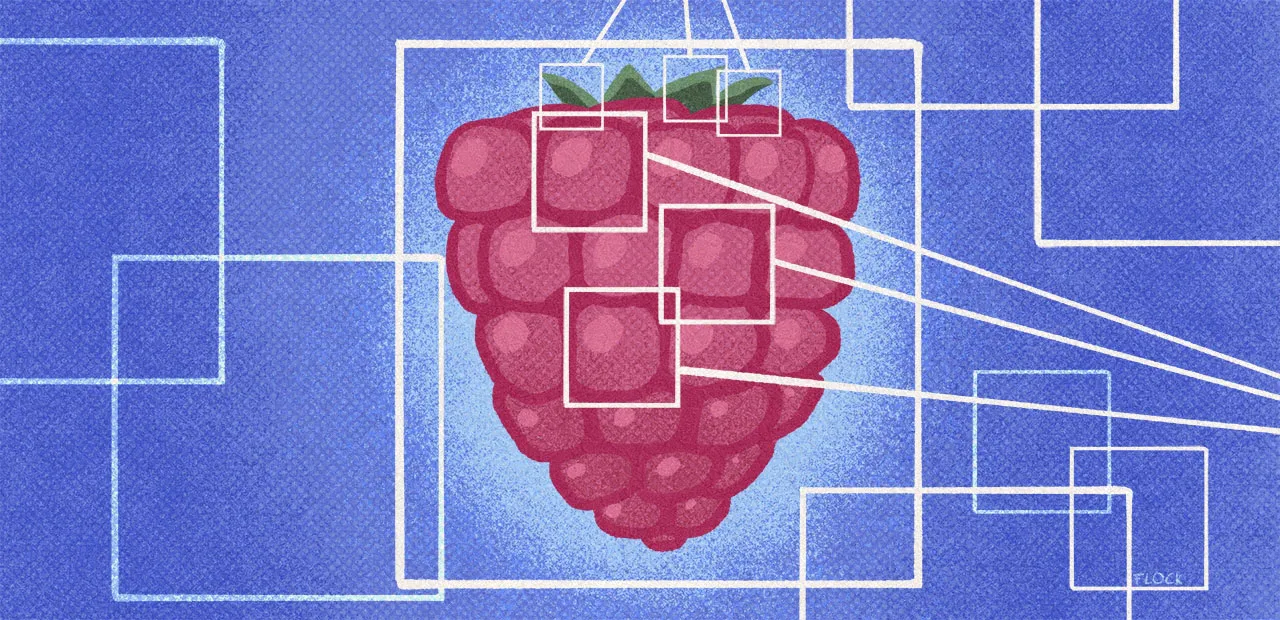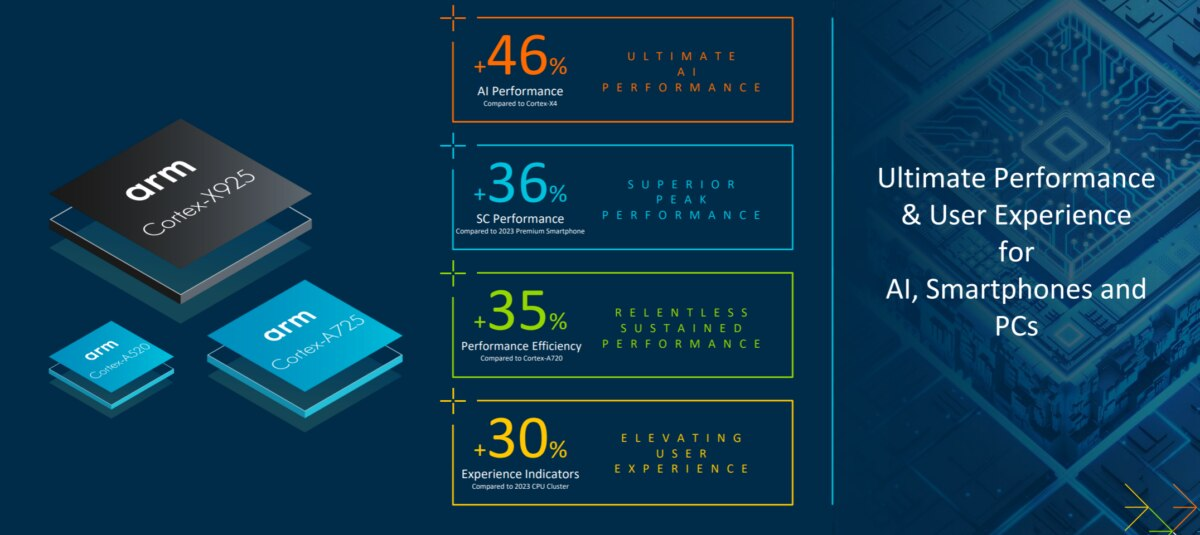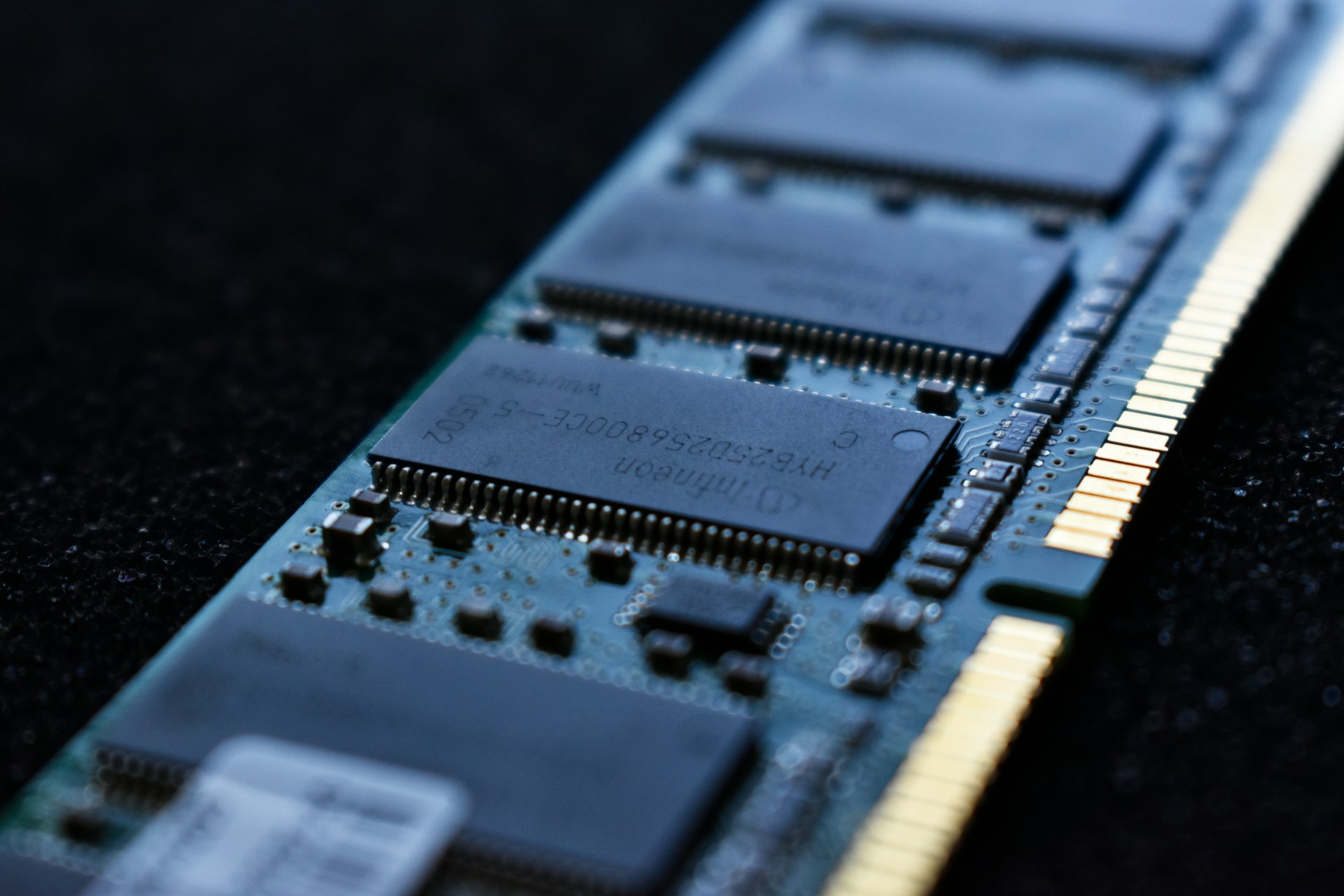Législatives 2024 : le décret est en ligne, avec les modalités et détails de l’élection
Dimanche, allez voter !
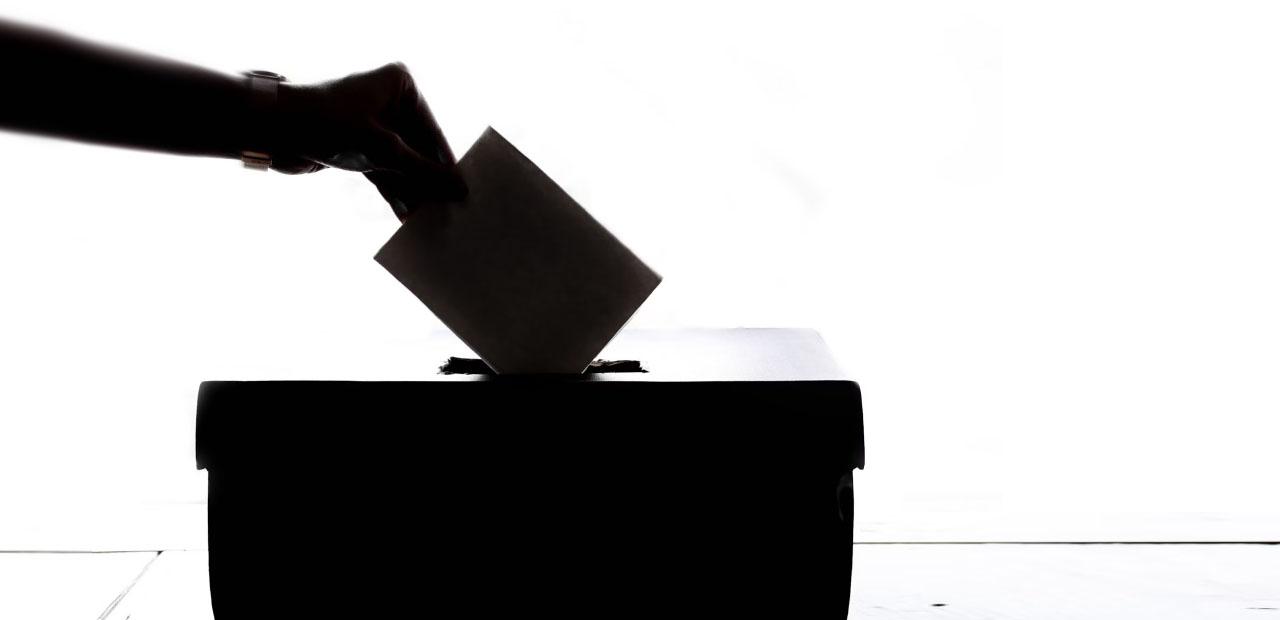
Hier, la soirée était chargée avec le résultat des élections européennes – dominées par le Rassemblement national (RN) avec 31,37 % des voix (les résultats au niveau européen se trouvent par ici) – et l’annonce dans la foulée de la dissolution de l’Assemblée nationale. Un pouvoir dont dispose le président de la République.
Il n’avait pas été utilisé depuis 1997, lorsque Jacques Chirac avait dissous l’Assemblée nationale. Cela avait abouti à une cohabitation, avec Lionel Jospin comme Premier ministre. C’est maintenant l’enjeu de ces élections législatives : élire les députés, puis par ricochet désigner le Premier ministre. Il est nommé par le président, mais doit appartenir au groupe majoritaire.
Tout d’abord, un rappel sur les délais. L’article 12 de la Constitution stipule que, après une dissolution, « les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution ». On est donc dans la fourchette basse, mais dans la fourchette quand même.
Code électoral vs Constitution
Sur X, Jean-Jacques Urvoas (ex-garde des Sceaux et professeur de droit public) expliquait dimanche soir que les dates choisies étaient « curieuses ». Il citait le Code électoral qui explique que les déclarations de candidatures doivent être déposées « à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin ».
Un délai qui repousserait le premier tour au 7 juillet, alors qu’il est programmé pour le 30 juin. Très tôt lundi matin, il ajoutait que, « après recherche l’art. 12 de la Constitution écrase l’art L157 comme l’a jugé le Conseil Constitutionnel décision no 88-5 ELEC du 4 juin 1988 ».
« C’est donc le décret de convocation des électeurs qui règlera la question du délai de dépôt des candidatures pour les prochaines législatives », décret qui est désormais en ligne (n° 2024-527 du 9 juin) et apporte quelques précisions sur le déroulement des faits.
Le décret fixe les détails
On commence par un rappel du calendrier : « Les électeurs sont convoqués le dimanche 30 juin 2024 » et, « par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les électeurs sont convoqués le samedi 29 juin 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain ». Le second tour se déroulera le 7 juillet, ou le 6 juillet pour les dérogations.
Il est précisé que « les déclarations de candidatures seront reçues par le représentant de l’État à partir du mercredi 12 et jusqu’au dimanche 16 juin 2024 à 18 heures (heure légale locale) ». Pour le second tour, les déclarations seront à déposer à partir de la publication des résultats et jusqu’au mardi 2 juillet 2024 à 18h. La campagne électorale débutera dans la foulée, soit à partir du « lundi 17 juin 2024 à zéro heure ».
Pas d’inscription sur les listes, vote électronique
Le décret ne permet par contre pas de s’inscrire sur les listes électorales : « L’élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R.14 du Code électoral telles qu’arrêtées à la date du présent décret ». Une exception : « Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, l’élection aura lieu à partir des listes électorales arrêtées le 29 février 2024 ».
Vous pouvez vérifier votre situation électorale sur cette page. Pour une procuration, c’est par là que ça se passe.
L’Article 10 précise que « le vote par voie électronique pour l’élection des députés des Français établis hors de France est ouvert le mardi précédant la date du scrutin, à 12 heures, et clos le jeudi précédant le scrutin, à 12 heures ».
L’Arcom commence son décompte demain matin
De son côté, l’Arcom explique que, « compte tenu de la brièveté de cette campagne, [l’autorité] appelle les éditeurs à une particulière vigilance quant au respect des règles en vigueur ». Elle leur demande de commencer les décomptes liés à l’élection à compter de ce mardi 11 juin 2024, dès 6h.
« Le principe de l’équité s’applique pendant toute la période précédant le scrutin. Afin de corriger d’éventuels déséquilibres des temps de parole dans les délais impartis, les médias audiovisuels devront transmettre les relevés à l’Arcom deux fois par semaine à compter du 17 juin 2024 pour ce qui concerne le premier tour », précise enfin l’Autorité.


 Qualcomm et vice-versa
Qualcomm et vice-versa