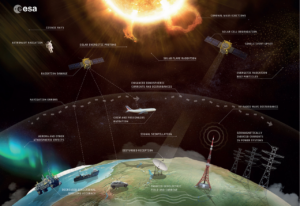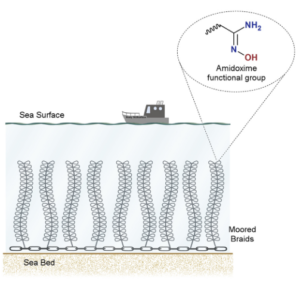Terres rares, graphite, silicium : la Chine durcit ses règles d’exportation et fait trembler la transition énergétique
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne cesse de s’intensifier. Pourtant, en mai dernier, un sommet avait réuni les deux superpuissances, en quête de désescalade. Mais tout dernièrement, ces efforts ne semblent pas avoir payé. Il en résulte des menaces concrètes sur l’approvisionnement de nombreux secteurs de l’industrie occidentale, dont celle de la transition énergétique.
Le 9 octobre, le ministre du Commerce chinois annonce un ensemble de mesures de contrôle des exportations. Un arsenal qui tape là où ça fait mal : les exportations de terres rares, de technologies permettant de les extraire et de les raffiner, ainsi que des composants technologiques qui les contiennent. En réponse, les États-Unis ont réagi avec force le 10 octobre : +100 % de taxes douanières supplémentaires sur les importations chinoises, qui s’ajoutent aux tarifs précédents, amenant ainsi à un total de 130 %. C’est à une véritable escalade à laquelle nous assistons.
La principale industrie visée par la Chine est en premier lieu celle de la Défense, mais le secteur des énergies renouvelables est tout autant affecté. Une part des mesures de contrôle s’applique aux terres rares, dont la liste vient d’être élargie : l’holmium, l’erbium, le thulium, l’europium et l’ytterbium s’ajoutent ainsi à la liste en vigueur depuis avril 2025, à savoir : samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutécium, scandium, et yttrium. Or ces matériaux entrent dans la composition des aimants nécessaires à certaines machines électromagnétiques (comme les générateurs ou les moteurs électriques), ou dans divers composants électroniques.
À lire aussi Terres rares et métaux stratégiques : pour gagner en souveraineté, l’Europe dévoile 47 projetsLe monopole sur les terres rares comme levier de puissance
La Chine a également imposé de nouvelles restrictions sur le graphite, et ce dernier est utilisé comme anode dans les batteries lithium-ion. Et cela aussi bien pour les batteries stationnaires que pour les véhicules. Les transferts d’équipements et les technologies permettant de produire des batteries sont également affectés, notamment concernant les batteries dont la densité énergétique dépasse 300 Wh/kg. Des permis seront en outre nécessaires pour exporter certains grades de silicium et les technologies utilisées pour la production de panneaux photovoltaïques.
La Chine entend moduler ses restrictions selon le partenaire commercial concerné. Elle cherche ainsi à utiliser sa suprématie sur la production de terres rares comme un levier de puissance. Ainsi que comme un levier économique, car il lui permet de concentrer son contrôle sur les technologies de la transition énergétique, et de sélectionner qui aura droit ou non à ses prodigieuses ressources. Côté occidental, le remplacement de la source chinoise de terres rares et de composants prendra nécessairement des années – et pourra conduire à de grandes difficultés environnementales. C’est donc une période pour le moins complexe pour tout le secteur énergétique qu’annonce l’escalade entre les deux grands rivaux de ce début du XXIᵉ siècle.
L’article Terres rares, graphite, silicium : la Chine durcit ses règles d’exportation et fait trembler la transition énergétique est apparu en premier sur Révolution Énergétique.