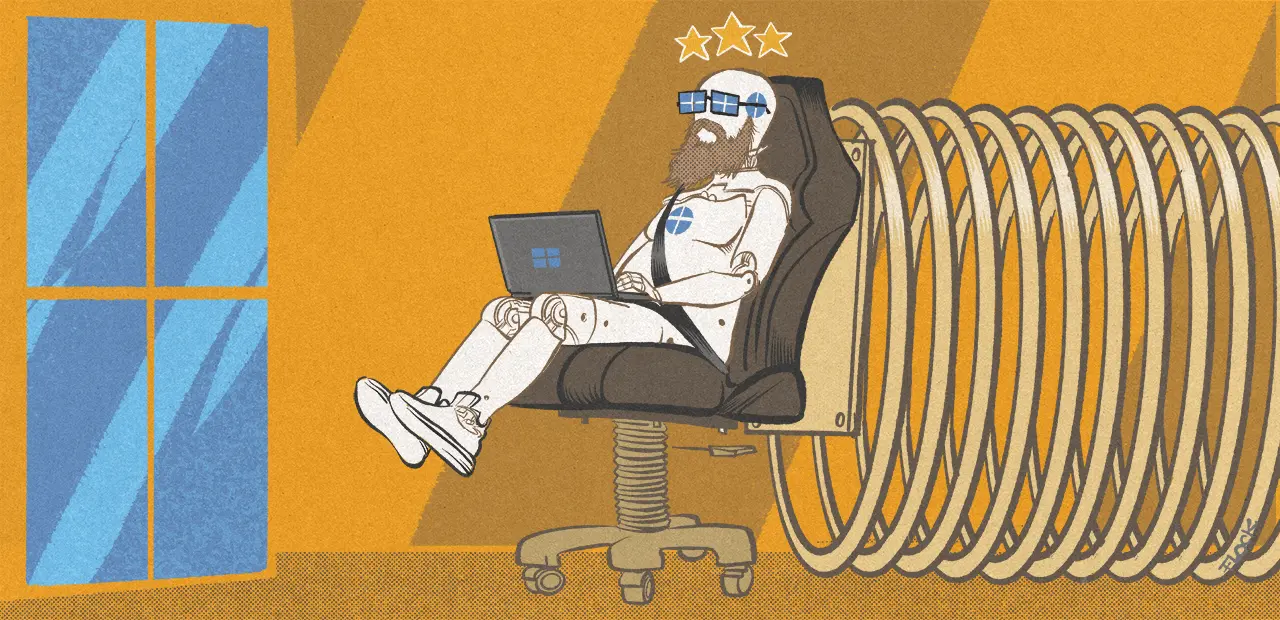You've got mail

Déjà propriétaire d’Evernote, de WeTransfer et bientôt de Vimeo, le groupe italien Bending Spoons annonce l’acquisition d’AOL, avec son portail Web et son webmail, auprès de Yahoo et de son actionnaire, le fonds Apollo Global Management. La transaction est évaluée à 1,5 milliard de dollars, financée par la dette.
AOL devrait à nouveau changer de main dans les prochains mois. Le célèbre portail américain, que d’aucuns ont découvert en France comme fournisseur d’accès à Internet au début des années 2000 (ah, les fameux kits de connexion distribués sur CD dans les magazines et les boîtes aux lettres), fait en effet l’objet d’une offre d’achat formulée par le groupe italien Bending Spoons.
Annoncée jeudi 29 octobre, celle-ci valorise AOL à hauteur de 1,5 milliard de dollars, principalement en raison des audiences toujours significatives du portail AOL.com et de sa messagerie en ligne. « Selon nos estimations, AOL est l’un des dix fournisseurs de messagerie électronique les plus utilisés au monde, avec une clientèle très fidèle comptant environ 8 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et 30 millions d’utilisateurs actifs mensuels », déclare Luca Ferrari, cofondateur et CEO de Bending Spoons.
L’acquéreur promet qu’il n’a pas l’intention de se contenter de capitaliser sur la notoriété historique de la marque. « Nous avons l’intention d’investir de manière significative pour contribuer à l’essor du produit et de l’entreprise », affirme encore le CEO, se targuant de n’avoir jamais vendu l’une des sociétés rachetées par son groupe.
Bending Spoons : une stratégie agressive de « build-up »
Si le nom AOL éveille forcément quelques souvenirs chez celles et ceux dont les cheveux grisonnent, Bending Spoons est totalement inconnu du grand public. Fondé en 2013 et basé à Milan, Bending Spoons repose sur une stratégie plutôt simple, expliquée par son cofondateur à Sifted en 2024 : racheter, de préférence à bon prix, des services ou des applications mobiles qui ont déjà fait leur preuve de marché puis les améliorer, ou en optimiser le fonctionnement, de façon à les rendre rentables.
Les bénéfices sont ensuite réinvestis sous forme de nouvelles acquisitions qui, à leur tour, sont censées autoriser de nouvelles optimisations, par le biais notamment des synergies. Dans le monde de la finance, on qualifie cette stratégie de build-up (littéralement accumulation). Elle suppose généralement de recourir à la dette pour financer les nouvelles acquisitions, et se traduit parfois par des efforts de rationalisation drastiques au niveau des entreprises rachetées.
Chez Bending Spoons, cette stratégie de croissance externe s’est considérablement accélérée à partir de 2022. Le groupe italien vient alors de réaliser sa première levée de fonds majeure. Et sa vision s’incarne à chaque fois par des plans de restructuration qui conduisent au licenciement de la majorité des effectifs de l’entreprise concernée.
Fin 2022, Bending Spoons s’offre l’application iPhone FiLMiC et son pendant payant FiLMiC Pro, puis l’outil de notes partagées Evernote début 2023. Les deux équipes sont licenciées, au nom d’un développement repris en interne au siège italien du groupe.
En 2024, Bending Spoons a de la même façon mis la main sur le studio mobile Mosaic Group, puis sur l’application de rencontres sociales Meetup, avant de s’offrir le service de partage de fichiers WeTransfer, puis la plateforme vidéo Brightcove pour quelque 230 millions de dollars. Chez WeTransfer, le changement de propriétaire se traduit par le départ de 75 % des salariés historiques.
En 2025, nouvelle fringale : le groupe met la main sur Komoot, l’outil allemand de création d’itinéraires et de promenades, pour 300 millions d’euros. Quelques semaines plus tard, les 150 salariés sont remerciés. Qu’adviendra-t-il des salariés de Vimeo ? La plateforme vidéo, un temps concurrente de YouTube, est en cours d’acquisition par Bending Spoons, qui a formulé une offre à 1,38 milliard de dollars.
710 millions de dollars levés et 2,8 milliards de dollars de dette
Le groupe italien peut maintenant se targuer de jouer dans la cour des grands. Début 2024, il lève 155 millions de dollars (en capital) auprès de plusieurs fonds d’investissement. Ce 30 octobre 2025, il annonce un nouveau tour de table, mais à hauteur de 710 millions de dollars cette fois, sur la base d’une valorisation préalable à 11 milliards de dollars.
En parallèle de ces capitaux, Bending Spoons indique avoir sécurisé une enveloppe de 2,8 milliards de dollars sous forme de dette bancaire. Celle-ci est destinée notamment à financer l’acquisition de Vimeo, et maintenant celle d’AOL, dont le nom n’évoquera décidément plus son positionnement marketing originel, America Online.
Une nouvelle page européenne pour AOL ?
Bending Spoons, qui revendique 300 millions d’utilisateurs mensuels sur ses applications et services, raisonne sans surprise sur un périmètre mondial. Le groupe met cependant un pied particulier aux États-Unis avec AOL puisque c’est là que l’ancien FAI compte le plus d’utilisateurs.
Rappelons qu’AOL, un temps présent en France, a connu des fortunes diverses depuis sa séparation avec le groupe Time Warner, en 2009. Un temps indépendant, le groupe a d’abord été racheté par l’opérateur Verizon en 2015 (pour 4,4 milliards de dollars), chez qui il sera rejoint l’année suivante par Yahoo. En 2021, nouveau changement de mains : Verizon cède le contrôle de ses activités média, auxquelles appartiennent AOL et Yahoo, au fonds Apollo Global Management.
D’après le Wall Street Journal, AOL générait chez Apollo un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 500 millions de dollars.