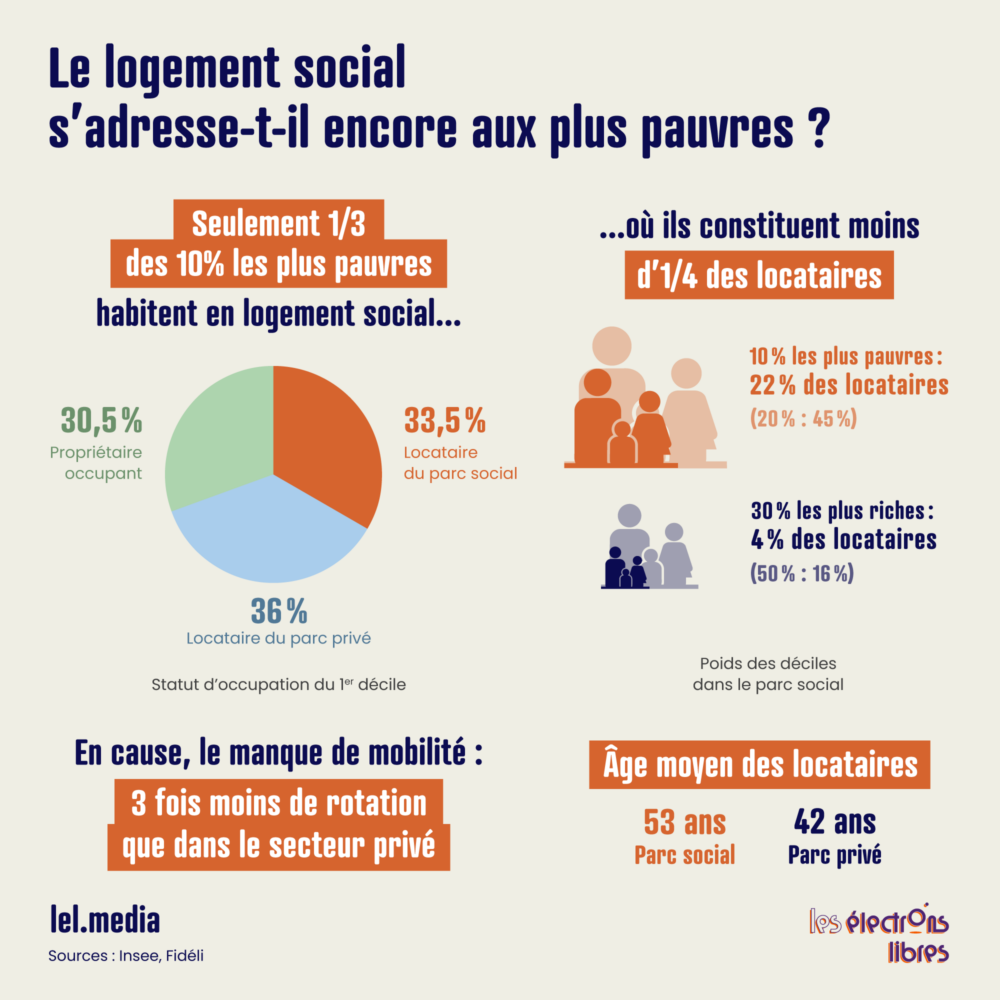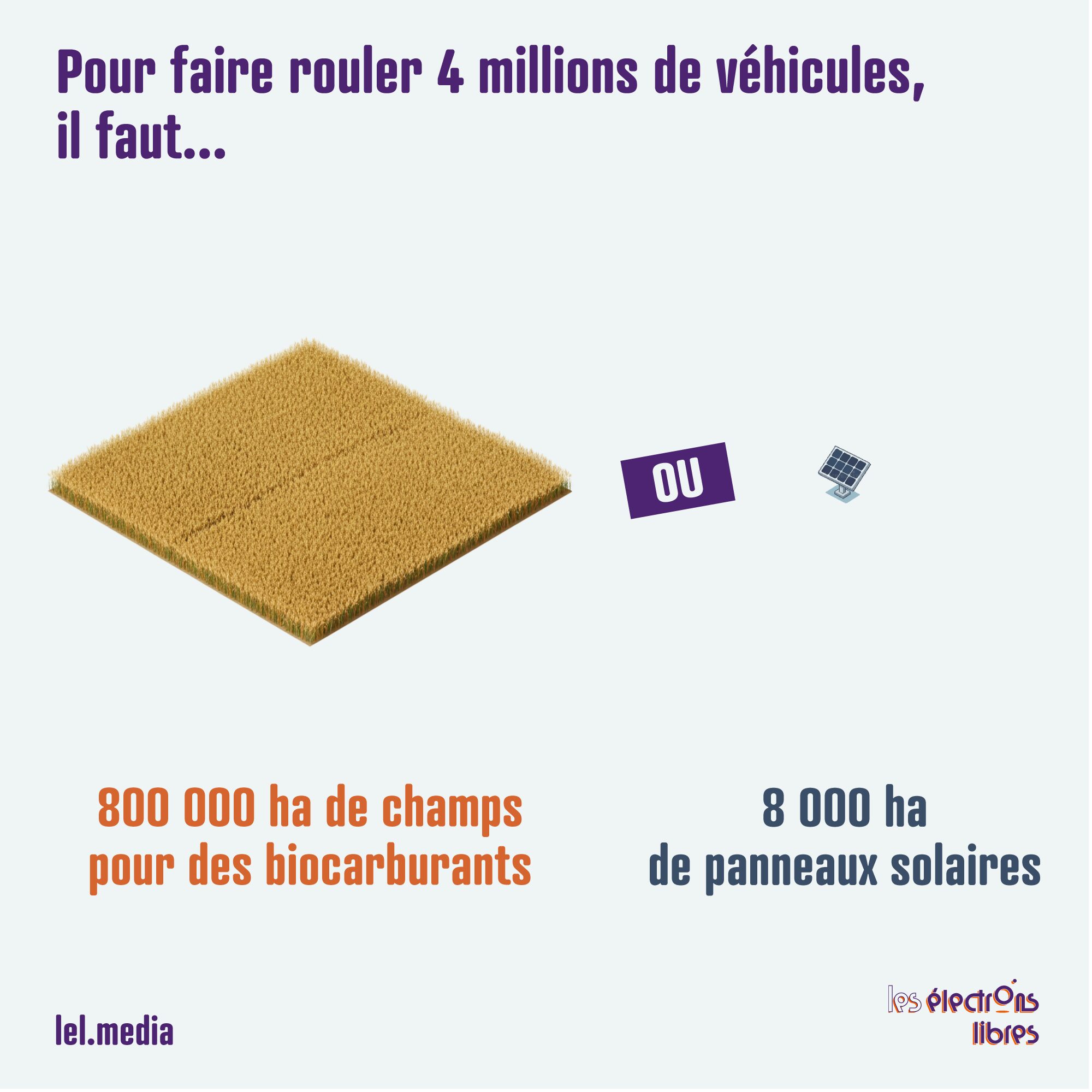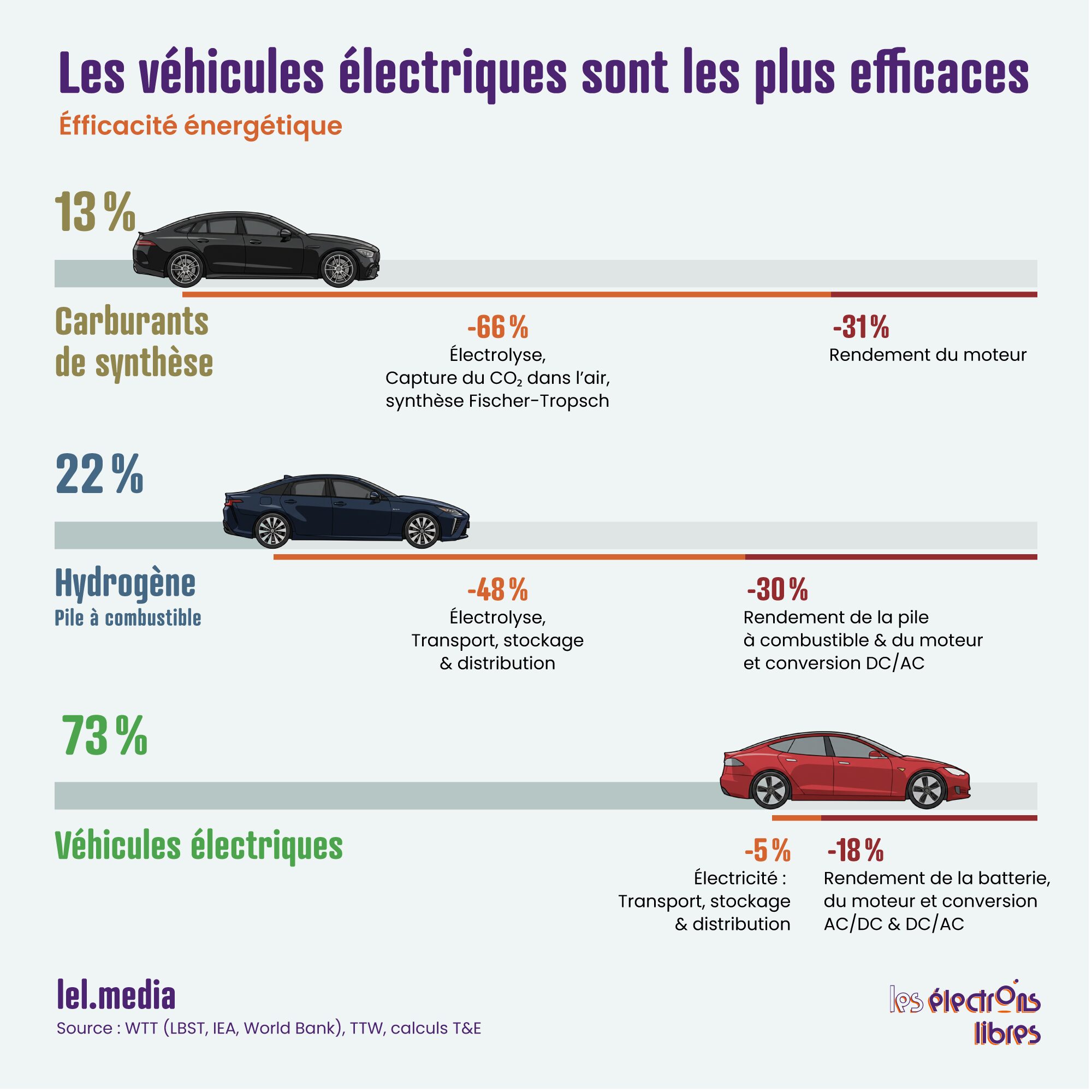Chasser ce riche que je ne saurais voir
« Il faut faire payer les riches ». Au Royaume-Uni, cette politique provoque un exil massif. Les recettes s’effondrent, au point de risquer de doubler les impôts de 25 millions de contribuables. Un avertissement pour la France, où la tentation revient avec insistance dans le débat public.
Le Royaume-Uni n’en finit plus de rompre avec ses héritages. Après son divorce avec l’Union européenne, c’est la dernière page du thatchérisme qui est en train de définitivement se tourner. La suppression du régime fiscal propre aux « non-domiciliés », à savoir les étrangers fortunés résidant au Royaume-Uni (mesure datant de 1799), a été doublement détricotée : en mars 2024 par le chancelier de l’Échiquier (l’équivalent du ministre des Finances) conservateur, Jeremy Hunt, décidant de l’extinction de ce régime à partir d’avril 2025, puis par sa successeure travailliste, Rachel Reeves, qui en a profité pour y ajouter un volet sur les droits de succession. Preuve qu’outre-Manche également, la passion pour la fiscalité transcende les clivages partisans.
Les résultats ne se sont pas fait attendre : le Royaume-Uni aurait perdu 10 800 millionnaires en 2024 selon le cabinet Henley & Partners, et près de 16 500 en 2025, devenant ainsi le premier pays du monde en termes d’exil de millionnaires. Une hémorragie qui ne fait que commencer : la banque UBS estime que le pays pourrait perdre jusqu’à 500 000 millionnaires d’ici 2028. Un comble pour un pays longtemps considéré comme la principale terre d’accueil des plus fortunés.

Les conséquences de ce « Wexit » (pour exil des riches) sont déjà observables. L’essayiste Robin Rivaton rappelle ainsi que c’est toute une chaîne qui est concernée, avec des effets en cascade : baisse de 45 % de la valeur des maisons « prime » de Londres, départs de magnats industriels comme Lakshmi Mittal, Nik Storonsky (fondateur de Revolut), Nassef Sawiris (première fortune d’Égypte) ou encore Guillaume Pousaz (fondateur de Checkout.com), baisse de 14 % des demandes de personnel domestique très haut de gamme, baisse du nombre d’élèves internationaux en internat de 14 % et fermeture de 57 écoles indépendantes.
Le Trésor britannique a en outre estimé que chaque départ de millionnaire coûtait 460 000 livres par an à l’État, soit la contribution fiscale annuelle d’environ 50 contribuables. Si les estimations de la banque UBS sont correctes, il faudrait donc doubler les impôts de 25 millions de contribuables anglais pour ne serait-ce que combler les pertes engendrées par cet exil !
La leçon anglaise est brutale pour eux, mais précieuse pour nous. Prenons-la comme un ultime avertissement pour stopper la folie fiscale qui s’est emparée de notre pays.
Alors que les économistes de gauche, apôtres d’une forte augmentation de la fiscalité sur le patrimoine (Gabriel Zucman et Thomas Piketty en tête), ne cessent d’ânonner que leur potion fiscale ne provoquera aucun exil, les économistes sérieux documentent cet effet depuis de nombreuses années, démontrant que « trop d’impôt tue l’impôt » et que le réel finit toujours par se venger.
La fin de ce régime fiscal devait théoriquement rapporter 34 milliards de livres sterling en cinq ans, mais l’exil qu’il provoque pourrait coûter 111 milliards de livres sur cette période, et conduire à la suppression de plus de 40 000 emplois, selon l’Adam Smith Institute.
Un effet similaire à celui observé en Norvège ces dernières années, où l’augmentation de la fiscalité sur le capital réalisée en 2021 (dans une mouture similaire à la taxe Zucman) devait rapporter 141 millions d’euros par an. Or, elle a en réalité généré un manque à gagner de 433 millions d’euros et provoqué une fuite des capitaux à hauteur de 52 milliards d’euros.
La France n’est pas en reste avec sa risible « taxe sur les yachts », produit purement idéologique dont les gains étaient estimés à 10 millions d’euros par an, alors que son rendement réel a été d’à peine 60 000 euros en 2024 (soit 160 fois moins), provoquant un exil quasi total des bateaux de luxe dans notre pays (il n’en resterait plus que cinq aujourd’hui), cassant toute l’économie et les emplois inhérents.
La fiscalité, un édifice fragile
La fiscalité est similaire à un Kapla, ce jeu de construction et d’adresse pour enfants où de fins bouts de bois doivent être empilés pour réaliser une structure verticale. L’ajout d’une pièce supplémentaire risque à chaque fois de faire basculer l’ensemble de l’édifice et de détruire tout l’ouvrage.
Alors que le vote d’une nouvelle taxe ou l’augmentation d’un impôt devrait se faire d’une main tremblante, assurée par des études d’impact évaluant les effets à attendre à moyen et long terme, les élus ne prennent plus aucune précaution, motivés par l’idéologie et la nécessité de répondre à ce qu’ils estiment être la demande de l’opinion. Si cette mécanique aveugle et brutale a fonctionné ces quarante dernières années pour les pays occidentaux, le double ralentissement démographique et économique les oblige à accélérer la cadence pour assurer le financement du fonctionnement d’États-providence de plus en plus déficitaires. Et dans un environnement où les personnes sont encore libres de leurs mouvements, tout alourdissement de l’imposition ne fait qu’inciter les personnes ciblées à placer leurs actifs dans des environnements moins propices au braconnage fiscal.
Un pays qui chasse ses riches est un pays qui s’appauvrit. Moins de fortunés induit moins de ressources pour développer l’investissement et favoriser l’innovation, moins de recettes pour financer les politiques publiques incontournables et surtout un effacement de l’habitus entrepreneurial dans un pays qui, en plus de perdre ses riches, perd des exemples à suivre pour ceux qui aspirent à le devenir.
En somme, cette politique revient à casser la machine à produire de la prospérité partagée et à offrir ses ressources intellectuelles et entrepreneuriales à d’autres pays plus attractifs, renforçant ainsi de futurs concurrents économiques.
Dans la compétition mondiale qui se joue entre les grandes zones économiques, l’Europe fait le choix mortifère d’alourdir des prélèvements obligatoires déjà très imposants, dans un contexte où la productivité et la démographie chutent, pour tenter de maintenir artificiellement l’idée que la générosité d’un modèle social est un horizon indépassable. Sans une remise en cause complète de ce modèle, et la définition d’une nouvelle matrice fiscale ambitieuse donnant la priorité à l’investissement, au risque et à l’innovation, le Vieux Continent endossera le rôle de proie de pays dynamiques à l’appétit insatiable.
L’article Chasser ce riche que je ne saurais voir est apparu en premier sur Les Électrons Libres.